Santé pharmaceutique : un outil de souveraineté au bord du dépôt de bilan, que fait l’Etat ?

Alors que le gouvernement multiplie les discours sur la relocalisation de la production industrielle, un fleuron stratégique de l’économie nationale agonise dans l’indifférence générale. La Santé pharmaceutique, installée à 23 kilomètres de Libreville dans la Zone économique spéciale de Nkok, est aujourd’hui au bord du dépôt de bilan. Cette usine, capable de produire jusqu’à un million de comprimés par jour, fabrique des médicaments génériques essentiels : antipaludéens, antirétroviraux, traitements contre le cancer, le diabète, etc. Elle emploie aussi des jeunes Gabonais hautement qualifiés dans des métiers techniques rares en Afrique. Pourtant, malgré ce potentiel, l’État reste muet, incapable de sauver ce champion national, à l’heure même où le monde se referme sur lui-même, au gré des conflits armés ravageurs.
En réalité, l’enjeu dépasse les frontières gabonaises. En effet, la Santé pharmaceutique est l’un des rares pôles technologiques pharmaceutiques de la sous-région, voire le seul à même de disposer d’une telle capacité de production et technologique. Avec une demande régionale croissante, notamment dans la zone Cemac, l’usine pourrait répondre aux besoins d’un marché de plus de 50 millions de consommateurs. Dans le contexte de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), elle représente un atout stratégique majeur. Préserver ce site, c’est assurer une forme de souveraineté sanitaire, diversifier l’économie et créer de la valeur ajoutée dans un pays encore trop dépendant de l’extraction de matières premières.
La Santé pharmaceutique au bord du dépôt de bilan
À la suite de la pandémie de Covid-19, plusieurs pays ont pris la pleine mesure de leur vulnérabilité sanitaire et ont réagi par des politiques audacieuses. La France, par exemple, a lancé le plan Innovation Santé 2030 avec l’objectif clair de relocaliser la production de médicaments critiques et d’assurer une autonomie sanitaire d’ici à la prochaine décennie. En Afrique centrale, les économistes ont eux aussi tiré des leçons de la crise en recommandant la mise en place d’unités de fabrication de médicaments essentiels, afin de réduire la dépendance chronique aux importations. Le Gabon, dans ce contexte, possède un atout majeur : l’usine Santé pharmaceutique de Nkok, un outil déjà opérationnel.
Pourtant, loin d’être valorisée, cette infrastructure industrielle est aujourd’hui menacée de dépôt de bilan. Un paradoxe flagrant quand on sait que les hôpitaux publics sont régulièrement en rupture de médicaments et que les patients, faute d’alternative, se ruent vers des pharmacies privées, souvent à des prix prohibitifs et à des heures impossibles de la nuit. Plus incohérent encore, les produits issus de cette entreprise gabonaise, jusqu’à 40 % moins chers que les médicaments importés, brillent par leur absence sur le marché local, alors même que le gouvernement proclame vouloir améliorer le pouvoir d’achat.
Un État incapable de flairer le potentiel de ses champions nationaux
Pourtant, les interrogations n’ont pas manqué pour tenter d’éclaircir les raisons de ce désintérêt étatique. Le courrier référencé 037-GMT-Juin-2025-IMO adressé au ministère de la Santé, afin de comprendre l’intégration éventuelle de la Santé pharmaceutique dans les politiques publiques, est resté sans réponse. Même silence du côté du ministère de l’Économie, sollicité via le courrier 039-GMT-Juin-2025-IMO pour connaître les obstacles à l’intégration des produits locaux dans le circuit national de distribution et leurs implications sur le coût de la vie. Seuls deux ministères ont daigné réagir. Le ministère de l’Industrie, d’abord, a reconnu que l’entreprise est « dans la situation d’une société en cessation de paiement », sans toutefois esquisser un plan de relance sérieux. Une simple réunion en mars dernier aurait évoqué une révision de l’actionnariat, mais aucun calendrier, aucun objectif ni aucune vision stratégique n’a été communiquée.
Quant au ministère des Affaires sociales, la réponse se limite à une formule de politesse, saluant l’initiative et la rattachant à la « vision des plus hautes autorités », sans rien dire du rôle que pourrait jouer la Santé pharmaceutique dans la rationalisation des dépenses de la CNAMGS. Ce silence généralisé illustre un désintérêt inquiétant, voire un amateurisme persistant de la part d’un gouvernement qui semble incapable d’identifier et de soutenir ses propres leviers de souveraineté. L’indifférence affichée à l’égard de la Santé pharmaceutique traduit un manque de coordination interinstitutionnelle et une absence de vision stratégique à long terme. Alors que la souveraineté sanitaire est devenue une priorité planétaire, le Gabon donne le spectacle d’un État prêt à saborder l’une de ses rares réussites industrielles. Laisser cette entreprise péricliter, c’est renoncer à un pilier potentiel de sécurité médicale, d’indépendance économique et de soutien au pouvoir d’achat. C’est aussi, plus profondément, faire le choix de l’improvisation au détriment d’une politique de santé publique ambitieuse et cohérente.




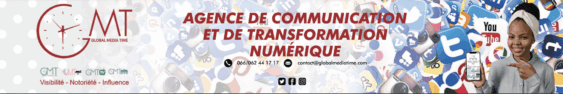





Très bien écrit, merci!