Gabon : création d’un comité pour éradiquer les produits cosmétiques éclaircissants

Le ministère de la Santé et des Affaires Sociales a adopté en octobre dernier un arrêté portant création du Comité Technique National d’Elimination des Produits Cosmétiques Éclaircissants pour la Peau (CTNEPCEP). Un organe qui s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de lutter plus efficacement contre l’usage des produits cosmétiques éclaircissants pour la peau très en vogue au sein de la population.
C’est dans l’optique de lutter contre la dépigmentation et les cancers relatifs à cette pratique grandissante au Gabon que cette décision a été prise par le gouvernement en 2023. En effet, cet arrêté signé par le ministre de la santé et des Affaires sociales Adrien Mougougou porte sur la création et les attributions de ce nouveau comité au sein du ministère dont il a la charge.
CTNEPCEP pour l’éradication de la dépigmentation
Ainsi, le Comité technique national d’élimination des produits cosmétiques éclaircissants pour la peau aura pour « mission d’accompagner l’agence du médicament ainsi que d’autres services techniques du gouvernement à la lutte contre la fabrication, l’importation, l’exportation, la distribution et l’usage des produits cosmétiques éclaircissants pour la peau contenant du mercure et d’autres substances dangereuses ».
Une initiative qui vise à protéger les populations contre ce phénomène communément appelé « Kwanza » dans les quartiers. Il faut dire que le blanchiment de la peau est une pratique très répandue. Malheureusement, les conséquences de l’utilisation des produits contenant du mercure et d’autres substances s’avèrent dangereuses et peuvent même être mortelles. Outre les risques de cancer, l’usage de ces produits augmenterait les probabilités de ralentissement du développement cérébral du fœtus et du nourrisson provoquant des risques d’intoxication chez le nouveau-né.
Le Comité technique national d’élimination des produits cosmétiques éclaircissants pour la peau comprend un comité de pilotage et un secrétariat technique. A noter que « Le CTNEPCEP peut recevoir du gouvernement d’autres missions liées à son domaine de compétence ».




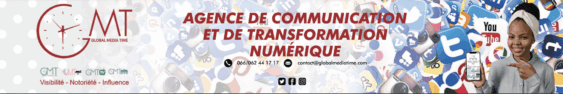





GMT TV
[youtube-feed feed=2]