Gabon : le droit de réponse, un principe ignoré qui fragilise l’État de droit

Le Code de la communication du Gabon, adopté par la loi n°019/2016 du 9 août 2016 et promulgué par décret n°0434/PR du 9 août 2016, consacre dans ses articles 12 et 13 un droit fondamental pour tout citoyen : le droit de réponse. L’article 12 dispose que « tout professionnel de la communication est tenu de diffuser gratuitement, dans un délai de 48 heures, un droit de réponse ou de rectification dans les conditions techniques et d’audience équivalente à celle du contenu mis en cause. Il peut, en tout état de cause, présenter des excuses par voie de presse ou par tout autre support de communication. L’élément de réponse ou de rectification doit être publié dans le même format que le contenu incriminé, sans commentaire. »
En complément, l’article 13 fixe un délai de prescription de trois mois pour exercer ce droit à compter de la diffusion du contenu litigieux. Sur le papier, la protection est claire : rapidité, équité de traitement et obligation stricte pour les médias. Mais dans la réalité gabonaise, ces dispositions restent largement méconnues et rarement appliquées.
Un droit ignoré, une insécurité juridique installée
Le droit de réponse devrait être un instrument démocratique majeur : il garantit l’équilibre du débat public et protège la réputation des citoyens. Mais faute de vulgarisation, la plupart des Gabonais ignorent qu’ils doivent agir dans un délai de trois mois, et que la presse a l’obligation de publier leur réponse gratuitement, sous le même format et sans commentaire.
Résultat : de nombreux justiciables saisissent la justice hors délai ou sans connaître les mécanismes exacts de rectification. Pire encore, certains officiers de police judiciaire et magistrats, mal formés sur le sujet, enclenchent des procédures inadaptées. Une confusion qui fragilise non seulement les droits des citoyens mais aussi la crédibilité de l’appareil judiciaire. L’État s’expose ainsi à des recours en responsabilité du fait de l’ignorance ou de la mauvaise application de ses propres textes.
L’État coupable de ne pas vulgariser le droit
L’adage « nul n’est censé ignorer la loi » prend un sens cruel lorsqu’aucun effort n’est consenti pour informer les citoyens. Ni le gouvernement, ni les institutions républicaines, ni même les ONG n’ont financé ou initié de campagnes d’éducation juridique populaire sur le Code de la communication. Conséquence : le droit de réponse, pourtant garanti par la loi, demeure un privilège pour une minorité avertie et non un outil de justice accessible à tous.
Ce déficit de pédagogie entretient une insécurité juridique chronique : les médias appliquent la règle de manière sélective, les magistrats l’interprètent de façon disparate, et les citoyens se sentent impuissants face aux atteintes à leur image. À défaut d’une vulgarisation massive, les articles 12 et 13 du Code de la communication restent des principes fantômes, invisibles dans la vie quotidienne.
Une urgence pour la démocratie gabonaise
Dans un État de droit digne de ce nom, la vulgarisation des textes juridiques est une condition de leur effectivité. L’article 12, en imposant la gratuité, la rapidité et la neutralité de la publication du droit de réponse, est l’un des garde-fous les plus importants contre les abus de la presse et les atteintes à la réputation. L’article 13, en fixant un délai précis, donne un cadre de sécurité juridique. Mais sans une campagne nationale de sensibilisation, ces garanties resteront lettre morte.
À l’heure où les autorités disent vouloir assainir la gouvernance et rapprocher l’État du citoyen, investir dans l’éducation populaire au droit est une urgence démocratique. Faute de quoi, les Gabonais resteront vulnérables, les magistrats désarmés, et l’État exposé à des crises de confiance récurrentes. Vulgariser les articles 12 et 13 du Code de la communication, c’est donner corps à l’adage : « nul n’est censé ignorer la loi ».




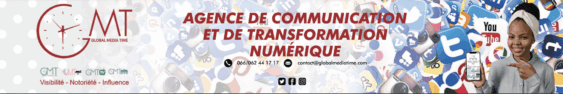





GMT TV
[youtube-feed feed=2]