CEAG : une ambition de souveraineté menacée par les failles logistiques du Gabon

Présentée comme une mesure phare pour stabiliser les prix et renforcer la souveraineté alimentaire, la Centrale d’Achat du Gabon (CEAG) se heurte déjà aux limites structurelles de l’économie nationale. Entre lourdeurs portuaires, réglementations contraignantes et risques de captation par le secteur privé, son efficacité pourrait être compromise.
Des ambitions contrariées par la logistique. Si la CEAG doit jouer un rôle central dans l’approvisionnement en produits essentiels, l’Indice de performance logistique (LPI) de la Banque mondiale rappelle la dure réalité : en 2023, le Gabon occupe le 115e rang sur 139 pays. Avec un temps de séjour moyen des conteneurs de 11,4 jours dans les ports, les achats centralisés pourraient être ralentis, réduisant la capacité de l’État à garantir des livraisons rapides et des prix stables.
À cela s’ajoutent les restrictions mises en lumière par l’Indice STRI de l’OCDE. Avec des scores élevés dans les services professionnels (66,7), les communications (62,4) et les transports (67), le Gabon se situe au-dessus des moyennes africaines et mondiales. En clair, la CEAG devra composer avec une réglementation lourde et des procédures administratives qui risquent d’alourdir ses coûts et d’allonger ses délais.
Le risque d’une captation par le privé
L’un des paradoxes soulevés par plusieurs observateurs réside dans la possibilité que la CEAG bénéficie davantage au secteur privé qu’aux consommateurs. Face aux lenteurs logistiques et aux barrières non tarifaires, l’État pourrait être contraint de recourir massivement à des partenaires privés pour assurer l’approvisionnement. Ce schéma transformerait la centrale en simple interface, où les économies promises seraient absorbées par des acteurs privés, sans bénéfice réel pour les ménages.
Par ailleurs, la centralisation des achats sans amélioration préalable des infrastructures logistiques — routes, corridors ferroviaires, modernisation portuaire — risque de fragiliser encore davantage l’équilibre territorial. Les zones urbaines, mieux desservies, capteraient l’essentiel des volumes, accentuant les inégalités avec les provinces enclavées.
Centraliser sans réformer : un pari risqué
En l’état, la CEAG illustre un paradoxe : vouloir rationaliser l’approvisionnement national sans réformer les fondations logistiques qui le soutiennent. Les lenteurs portuaires, le déficit d’infrastructures et la faiblesse du suivi logistique compromettent sa capacité à peser réellement sur la lutte contre la vie chère.
Sans une modernisation vigoureuse des douanes et des infrastructures, la CEAG risque de se transformer en simple outil de redistribution vers le privé, loin de sa vocation initiale de protection des consommateurs et de renforcement de la souveraineté alimentaire.




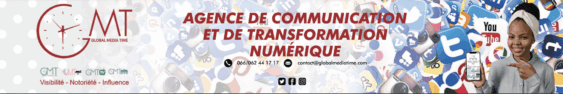



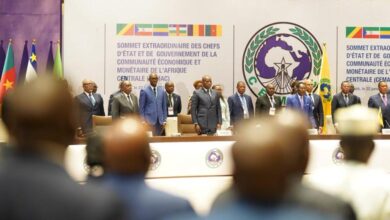
GMT TV
[youtube-feed feed=2]