Reconnaissance des territoires autochtones : un levier clé pour la biodiversité dans le Bassin du Congo

Réunis à Libreville les 1er et 2 août 2025, les représentants des États membres de la Comifac, des communautés locales et des partenaires techniques ont souligné l’urgence d’harmoniser les cadres juridiques et de valoriser les savoirs traditionnels pour une conservation efficace et équitable des écosystèmes.
Alors que le Bassin du Congo représente le deuxième poumon vert de la planète, sa préservation passe désormais par une reconnaissance accrue des efforts communautaires. C’est le message fort qu’a porté l’atelier régional sur les Aires du patrimoine autochtone et communautaire (APAC), organisé à Libreville avec le concours des États membres de la Commission des forêts d’Afrique centrale (Comifac), dont le Gabon, la RDC, le Cameroun et la RCA, ainsi que des représentants autochtones et de nombreux partenaires financiers.
Repenser la gouvernance environnementale autour des communautés
Durant deux jours, les échanges ont permis de dresser un état des lieux des initiatives communautaires de conservation, souvent marginalisées dans les politiques publiques. Plusieurs recommandations ont émergé, parmi lesquelles la création d’un répertoire régional des savoirs traditionnels, leur intégration dans les politiques nationales de conservation, ainsi que la consolidation des indicateurs de performance à l’échelle sous-régionale.
« Les territoires autochtones doivent être juridiquement reconnus comme des contributeurs à part entière aux objectifs internationaux de protection de la biodiversité », a souligné Chouaibou Nchoutpouen, secrétaire exécutif adjoint de la Comifac. Il a insisté sur la nécessité d’inscrire les APAC dans la mise en œuvre de la cible 3 du Cadre mondial pour la biodiversité, ainsi que des Objectifs de développement durable (ODD 15) et de l’Accord de Paris sur le climat.
De la reconnaissance symbolique à la sécurisation juridique
Les discussions ont également mis en évidence la nécessité de passer d’une reconnaissance informelle à une sécurisation juridique effective des territoires communautaires. Pour les participants, il s’agit de combler le fossé entre les engagements environnementaux pris par les États et la réalité vécue par les communautés rurales, souvent premières gestionnaires des ressources naturelles.
L’atelier a notamment recommandé la mise en place d’un comité sous-régional sur les APAC, chargé de suivre les efforts de conservation communautaire, d’assurer le partage des données spatiales, et d’impliquer systématiquement les points focaux nationaux dans les processus de validation juridique.
« Le savoir ancestral des peuples autochtones n’est pas une simple tradition, c’est une science locale qui mérite d’être reconnue à sa juste valeur dans nos politiques », a résumé un participant venu de la RDC.
Dans un contexte de pressions croissantes sur les ressources forestières, cet atelier s’impose comme un tournant vers une conservation inclusive, durable et fondée sur la justice environnementale. Le défi reste désormais de traduire ces engagements en actes concrets à l’échelle nationale.




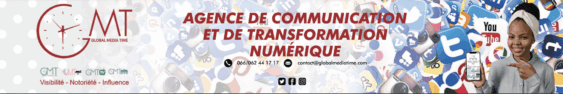





GMT TV
[youtube-feed feed=2]