Municipales 2025 : comprendre le principe de la proportionnelle à la plus forte moyenne

Le 27 septembre prochain, les gabonais seront appelés aux urnes pour renouveler les Conseils départementaux et municipaux. Au total, 3 078 élus locaux devront être désignés. Mais au-delà de ce vote citoyen, se cache une mécanique électorale complexe, celle de la répartition des sièges selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne. Derrière cette formule technique se joue en réalité l’équilibre des pouvoirs locaux et la désignation des exécutifs municipaux.
L’élection municipale est encadrée par la Loi organique n°001/2025 du 19 janvier 2025 portant Code électoral en République gabonaise. Les conseillers municipaux et départementaux sont élus au suffrage universel direct, à tour unique, sur la base de listes bloquées, pour un mandat de cinq ans renouvelable. Mais une fois les suffrages dépouillés, l’enjeu n’est pas seulement de savoir quelle liste est arrivée en tête. Il s’agit surtout de déterminer comment répartir les sièges au sein des conseils et, à travers eux, de désigner les responsables exécutifs, maires, adjoints et présidents, vice-présidents des Conseils départementaux. C’est ici qu’intervient la proportionnelle à la plus forte moyenne, une règle qui garantit une représentation équilibrée des forces politiques, tout en donnant un avantage mesuré aux listes les mieux placées.
La mécanique de la répartition des sièges
Concrètement, l’attribution des sièges se déroule en deux étapes. D’abord, on calcule le quotient électoral, obtenu en divisant le nombre total de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Cela permet de savoir combien de voix sont nécessaires pour décrocher directement un siège. Dans un exemple simplifié, un Conseil municipal de 5 sièges ayant enregistré 200 suffrages exprimés fixe son quotient à 40 voix par siège. Ainsi, une liste qui recueille 100 voix obtient immédiatement 2 sièges, une autre qui en obtient 70 décroche un 1 siège, et une troisième qui n’atteint que 30 voix n’en obtient aucun. Mais à ce stade, il reste encore des sièges à attribuer. C’est là qu’intervient la règle de la plus forte moyenne.
Cette règle consiste à diviser le nombre de voix obtenues par une liste par le nombre de sièges déjà attribués, augmenté de un. Dans l’exemple précédent, la liste A (100 voix, déjà deux sièges) obtient une moyenne de 33, la liste B (70 voix, un siège) obtient 35, et la liste C (30 voix, aucun siège) obtient 30. C’est donc la liste B, avec la plus forte moyenne, qui décroche le siège suivant. L’opération est répétée jusqu’à ce que tous les sièges soient distribués. Résultat : la liste A finit avec trois sièges, la liste B avec deux, et la liste C reste exclue du conseil. Cette méthode assure une représentation proportionnelle aux voix exprimées, tout en facilitant la constitution de majorités stables pour gouverner.
Forcer le jeu d’alliances politiques
Au-delà des chiffres, cette mécanique révèle toute l’importance des alliances politiques locales. Une liste qui ne parvient pas à obtenir la majorité absolue, c’est-à-dire plus de la moitié des voix, doit composer avec d’autres forces pour espérer contrôler un conseil. La désignation du maire, des adjoints ou encore des présidents des Conseils départementaux dépend directement de ces équilibres. Ces responsables sont élus lors de la première session du Conseil, convoquée dans les huit jours suivant le scrutin, à bulletin secret : à la majorité absolue au premier tour, puis à la majorité relative au second. Autrement dit, ce qui se joue le 27 septembre ne se limite pas au dépôt d’un bulletin de vote, mais ouvre un processus où stratégies, négociations et compromis deviennent essentiels pour peser dans la gouvernance locale.
Ainsi, comprendre la proportionnelle à la plus forte moyenne, ce n’est pas seulement s’initier à une règle mathématique abstraite. C’est saisir comment, derrière chaque siège attribué, se dessine la carte politique des communes et départements du Gabon. C’est aussi prendre conscience que les choix électoraux influencent bien au-delà du jour du scrutin. En effet, ils conditionnent la possibilité pour un parti ou une coalition de gouverner, de contrôler une mairie stratégique, ou de peser dans un conseil départemental. En ce sens, la mécanique électorale, aussi technique qu’elle puisse paraître, est au cœur de la vie démocratique locale et de l’avenir politique du pays.




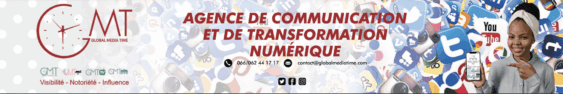





GMT TV
[youtube-feed feed=2]