Gabon : CQFS sur le solde budgétaire !

Le solde budgétaire désigne la différence entre les recettes totales de l’État en l’occurrence les impôts, les taxes, les droits de douane, les revenus pétroliers et non pétroliers, dons, etc, et ses dépenses totales liées au fonctionnement, aux investissements, aux salaires, aux transferts sociaux, au service de la dette. Exprimé en pourcentage du PIB, il est positif quand les recettes excèdent les dépenses, on parle de solde excédentaire, et négatif dans le cas inverse, on parle dans ce cas de solde déficitaire.
Cet indicateur est au cœur de la gestion des finances publiques. Et pour cause, il mesure la soutenabilité des politiques budgétaires, la capacité d’un État à financer ses ambitions sans creuser une dette excessive, et sa résilience face aux chocs externes. Par exemple, un excédent budgétaire permet de constituer des réserves ou de rembourser la dette. A contrario, un déficit chronique, lui, accroît la vulnérabilité aux taux d’intérêt, dégrade la notation souveraine et peut déclencher des crises de confiance.
Le solde budgétaire en chute libre au Gabon !
Pour les pays de la CEMAC, le critère de dette publique plafonnée à 70 % du PIB et l’équilibre budgétaire font partie des normes communautaires de convergence. Au Gabon, le solde budgétaire a basculé brutalement ces dernières années. Après un excédent de 1,8 % du PIB en 2023, il a plongé à –3,7 % en 2024, selon les estimations de la Banque mondiale publiées en octobre 2025. Les prévisions à moyen terme restent préoccupantes avec notamment –3,8 % en 2025 puis –4,0 % en 2026.
Une légère amélioration à –2,9 % est envisagée en 2027. Ce retournement de 5,5 points de PIB en une seule année est l’un des plus brutaux de la sous-région. La cause principale d’une telle situation aux répercussions évidentes est l’explosion des dépenses publiques qui ont augmenté de 24 % en 2024. Le gouvernement de transition a massivement investi dans les infrastructures et multiplié les mesures sociales post-transition. Au nombre de celles-ci, la hausse des salaires des fonctionnaires et le retour des bourses pour les élèves du secondaire.
Ces choix, légitimes sur le plan politique, ont été financés par l’emprunt plutôt que par une croissance des recettes. Puisque côté recettes, la chute des cours du pétrole de –15 % en moyenne sur l’année a amputé les rentrées pétrolières de près de 20 %. Sapristi ! Résultat, les efforts de mobilisation des recettes non pétrolières n’ont compensé que partiellement ce manque à gagner. Ce qui a maintenu la situation de déficit, qui a dû être comblé par un recours massif à la dette. Conséquence directe, la dette publique a bondi à 72,5 % du PIB fin 2024, selon la Banque mondiale.




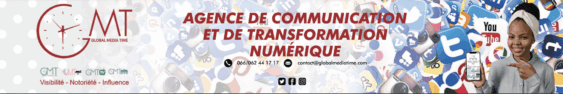


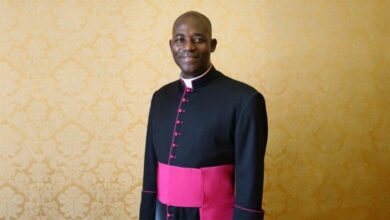


Manque de maitrise du concept, analyses peu sérieuses par la Banque Mondiale avec plusieurs zones obscures… Normalisations communautaires fallacieuses et liberticides, au mépris de l’économie, pour vénérer la finance et donc faire allégeance aux prêteurs !
Le concept d’autosuffisance ne semblerait-il pas antinomiques a la dette et que la finance nettement centrée sur elle en serait un poids supplémentaire, capable même de l’asphyxier ?
Il faudra toujours rappeler que le budget demeure une prévision chiffrée dont la précision des réalisations demeure toujours aléatoire. Autrement dit, l’analyse budgétaire reste le plus souvent un moteur de promotion au financement des ressources via la dette, que ces données soient « tenables » ou pas ! Derrière cela figurent également d’autres arrangements politiques souvent au profit des négociateurs…
Très peu n’ont jusque-là pas compris que la finance étouffe l’économie et que la dette asphyxie l’autonomie d’un Etat. Plusieurs théories sur l’emprunt démontrent que ce dernier élève la rentabilité des actionnaires, soit !
Autant approfondir les recherches pour comprendre combien la matrice divertit toujours l’intelligence factuelle !
Remerciement pour ce reportage tout en motivant l’effort vers l’excellence car la matrice tue, endoctrine et promeut la cécité !