Gabon : à quand l’effectivité de l’apprentissage des langues vernaculaires dans le système éducatif ?

Annoncée en grande pompe en 2023, l’introduction des langues maternelles dès la maternelle et dans le cursus scolaire aurait dû être une réalité à la rentrée 2024-2025. Présentée comme une réforme essentielle pour préserver l’identité culturelle et linguistique du pays, cette mesure reste pourtant lettre morte, suscitant des interrogations sur la volonté réelle du gouvernement de la mettre en œuvre.
Une réforme annoncée, mais sans mise en application. Selon les déclarations de la ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, l’enseignement des langues locales devait être intégré au programme scolaire dès la rentrée 2024-2025. Des établissements pilotes avaient même été identifiés, et un support pédagogique – le Dictionnaire des Mwanas avec Papito et Jolioca d’Angèle Yeno Traoret – devait servir de base avec cinq langues sélectionnées : le fang, l’ipunu, l’omyènè, le nzebi et l’obamba.
Mais plusieurs mois après cette annonce, aucun changement concret n’est observé dans les établissements scolaires. Silence radio du côté du gouvernement, et dans les salles de classe, la langue française reste dominante, tandis que l’anglais s’impose dans les écoles privées et conventionnées. Un décalage flagrant entre l’ambition affichée et la réalité du terrain.
Un enjeu éducatif et identitaire sous-estimé
L’apprentissage des langues locales dès le bas âge est pourtant fondamental, tant sur le plan culturel qu’intellectuel. Avec un temps scolaire moyen de 6 à 10 heures par jour, l’école représente le cadre idéal pour transmettre des savoirs linguistiques et favoriser un ancrage culturel fort. « Apprendre une langue, c’est transmettre une identité et renforcer la cohésion sociale. Ce projet aurait permis aux jeunes de se reconnecter à leurs origines », souligne un enseignant du secondaire.
En plus de préserver le patrimoine culturel, cette réforme aurait pu renforcer le brassage linguistique. Il serait naturel qu’un ressortissant nzebi maîtrise le fang et puisse occuper des responsabilités dans une région où cette langue est majoritaire, sans crainte de barrières linguistiques ou culturelles.
Des paroles aux actes : une nécessité pour préserver l’identité gabonaise
Face à une mondialisation galopante et à une jeunesse de plus en plus éloignée de ses racines, il est urgent de redonner du poids aux langues vernaculaires. En retardant la mise en application de cette réforme, le gouvernement freine un processus essentiel pour la sauvegarde du patrimoine linguistique national. « Nos langues disparaissent peu à peu, et si l’État ne prend pas ses responsabilités, nous perdrons une partie essentielle de notre culture », regrette un linguiste gabonais.
Si le CTRI ambitionne réellement de restaurer les institutions, il est impératif que l’éducation soit au cœur des priorités et que cette réforme devienne une réalité tangible, plutôt qu’un projet abandonné dans les tiroirs de l’administration.
Josée Biloghe, Journaliste stagiaire




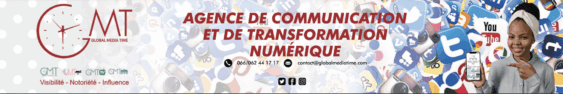
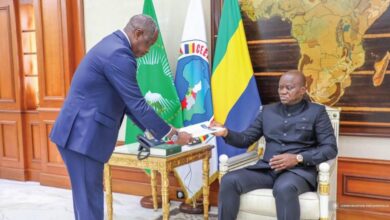




GMT TV
[youtube-feed feed=2]