Climat : Flore Ntsatsiesse éclaire le rôle croissant des juges internationaux dans la lutte contre le dérèglement climatique

Maître de conférences et désormais conseiller juridique du président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, la juriste Flore Ntsatsiesse vient de publier une étude remarquée dans La Revue des droits de l’Homme n°28. Intitulé Les armes du juge international dans la lutte contre le changement climatique, son article explore l’arsenal juridique que les juridictions internationales mobilisent pour contraindre les États à respecter leurs engagements climatiques.
Longtemps cantonnée aux sommets diplomatiques et aux négociations interétatiques, la lutte contre le changement climatique gagne désormais les enceintes judiciaires. Dans une analyse fouillée et rigoureuse, Flore Ntsatsiesse met en lumière l’émergence d’un pouvoir juridictionnel global, incarné par la Cour internationale de Justice (CIJ), le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) ou encore les cours régionales des droits de l’homme, qui prennent position face à l’inaction climatique.
Ces institutions, observe la juriste gabonaise, se saisissent de leur mandat pour protéger les États les plus vulnérables – notamment les petits États insulaires menacés de disparition – et défendre les droits fondamentaux des citoyens affectés par les bouleversements climatiques.
Vers une justiciabilité des engagements climatiques
Dans un contexte où les États rechignent souvent à voir leurs politiques climatiques soumises à un contrôle judiciaire, Flore Ntsatsiesse montre que les juges innovent. Le Tribunal international du droit de la mer, par exemple, a reconnu que les émissions de gaz à effet de serre constituent une pollution du milieu marin, ouvrant ainsi la voie à un contrôle juridictionnel des budgets carbone. Une avancée décisive, même si les contours de cette compétence restent à consolider.
La Cour internationale de Justice, quant à elle, s’appuie sur l’article 14 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et sur l’Accord de Paris pour encadrer et éventuellement sanctionner les manquements étatiques. Elle forge progressivement, parfois par voie prétorienne, des mécanismes de coercition juridique permettant de contourner les blocages politiques.
Un équilibre à trouver entre droit et diplomatie
Pour autant, l’étude de Flore Ntsatsiesse ne tombe pas dans un juridisme naïf. Elle insiste sur le double enjeu juridique et politique de cette évolution. Car si les juridictions internationales progressent dans la reconnaissance de leur rôle climatique, leur efficacité dépend aussi de leur capacité à dialoguer avec les États et à intégrer l’action judiciaire dans les dynamiques politiques globales.
L’ambition de ce travail est claire : équiper la communauté internationale d’outils juridiques solides pour faire respecter le droit climatique, au-delà des volontés politiques fluctuantes. Et dans ce cadre, la justice devient un levier stratégique dans la défense de la planète.
Une voix gabonaise au cœur du débat climatique mondial
Par la portée de son article et sa publication dans une revue juridique de référence, Flore Ntsatsiesse confirme son rayonnement intellectuel à l’échelle internationale, tout en plaçant le Gabon dans le cercle restreint des pays africains capables de produire une doctrine climatique ambitieuse.
Son travail servira autant aux juges qu’aux décideurs, aux entreprises, aux ONG ou aux juristes soucieux de perfectionner les instruments de la justice climatique. Alors que l’urgence écologique ne cesse de s’intensifier, cette étude apparaît comme une contribution doctrinale essentielle à la construction d’un droit climatique contraignant, universel et efficace.




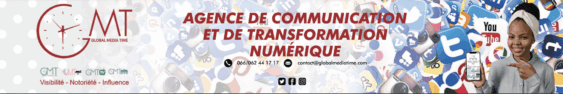





GMT TV
[youtube-feed feed=2]