«Alternative – Législatives & Locales 2025 » : miser sur des «Centres de Services Partagés» pour transformer l’auto-emploi

Portée DYNAMIQUE ALTERNATIVE à l’initiative de l’ancien candidat à l’élection présidentielle du 12 avril 2025, Axel Stophène Ibinga Ibinga, l’initiative « Alternative – Législatives & Locales 2025 » place l’auto-emploi au cœur de sa réponse au chômage. Sa boussole : des Centres de Services Partagés (CSP) implantés dans les chefs-lieux de provinces et de départements, pensés comme des incubateurs publics où s’agrègent équipements mutualisés, formations, mentorat, guichet unique et passerelles vers l’ANPI, les banques et la microfinance. Objectif : faire émerger et faire durer des micro-entreprises locales.
Des incubateurs “clés en main” adossés aux territoires. Dans la vision défendue par Axel Stophène Ibinga Ibinga, les CSP ne sont pas de simples salles d’alphabétisation économique. Ce sont des ateliers productifs dotés d’équipements mutualisés par filière : ateliers agro-transformation (odika, gnetum, moabi), fab-labs artisanaux (menuiserie, métal, textile), unités légères pour la bioénergie (briquettes issues des déchets verts et résidus forestiers) et pôles économie circulaire (tri, recyclage, conditionnement).
Adossés aux communes et départements dans une logique intercommunale, ces centres doivent fournir un socle technique (machines, normes d’hygiène, packaging) et un socle administratif (création d’activité, fiscalité locale, immatriculation, protection sociale) pour réduire les coûts d’entrée sur le marché.
Du guichet unique aux financements : fluidifier le parcours entrepreneurial
Le dispositif promet un guichet unique local pour l’ensemble des démarches, des parcours de formation courts (gestion, qualité, sécurité, e-commerce) et un mentorat assuré par des professionnels. Côté financement, le projet annonce des passerelles opérationnelles : conventions ANPI, lignes dédiées en microfinance, et mécanismes de co-investissement public-privé pour l’achat d’équipements lourds.
Pour éviter l’effet “coquille vide”, l’architecture prévoit des contrats de performance entre collectivités et gestionnaires des CSP, avec un pilotage par tableaux de bord trimestriels (inscriptions, entreprises créées, chiffre d’affaires agrégé, emplois, taux de remboursement, sinistralité).
Des résultats mesurables sous 24 mois
Le réalisme du projet se joue sur la durabilité des entreprises. L’Alternative fixe un horizon clair : taux de survie à 24 mois comme indicateur cardinal, complété par : Taux d’insertion (proportion d’apprenants devenus entrepreneurs ou salariés) ; coût par emploi créé (capex + opex du centre / emplois nets) ; part de la valeur ajoutée locale (transformation sur place vs. export de matière brute) et parité et inclusion (au moins 40 % de femmes et 30 % de jeunes dans les cohortes).
L’ambition affichée est d’aligner les premières cohortes de bénéficiaires sur des filières bancables – bioénergie, produits forestiers non ligneux, gestion des déchets – où la demande est tangible et les débouchés identifiés (cantines scolaires, hôpitaux, marchés urbains, BTP local).
Gouvernance, tarifs, accès : les garde-fous annoncés
Pour prévenir rentes et clientélisme, la feuille de route d’Axel Stophène Ibinga Ibinga introduit : une tarification sociale des ateliers (forfait horaire subventionné, gratuité partielle pour les publics vulnérables) ; des règles d’allocation transparentes des créneaux machines ; un registre numérique intercommunal retraçant équipements, bénéficiaires, volumes produits et marchés obtenus et des audits indépendants publiés, et un comité citoyen de suivi.
Le pari politique : faire du local un levier national
En reliant formation, outil productif et financement, l’Alternative veut dépasser les programmes de “sensibilisation” sans débouchés. Le positionnement d’Axel Stophène Ibinga Ibinga est assumé : l’auto-emploi comme politique industrielle de proximité. Si les CSP livrent, d’ici deux ans, des taux de survie robustes et un coût par emploisoutenable, le dispositif pourrait devenir une colonne vertébrale de la lutte contre le chômage, avec des retombées visibles sur les revenus des ménages et la transformation locale des ressources.
Reste l’épreuve des faits : équipements réellement disponibles, financements effectivement décaissés, marchés conquis. C’est sur ces points que se jouera la crédibilité d’un projet qui entend prouver qu’au Gabon, l’incubation publique peut rimer avec création d’emplois durables – et que l’engagement politique peut se mesurer indicateurs à l’appui.




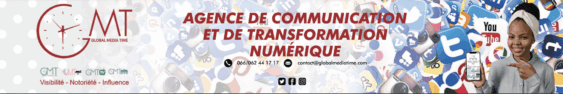





GMT TV
[youtube-feed feed=2]