Adhésion du Gabon à la Cour Internationale Islamique de Justice : une initiative louable ou une contradiction constitutionnelle majeure ?

Le projet de loi d’adhésion du Gabon au Statut de la Cour Internationale Islamique de Justice (CIIJ), approuvé par le gouvernement le 17 janvier 2025 et relayé par le média Gabon Média Time, constitue une nouvelle étape dans l’engagement du pays au sein de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), dont il est membre depuis 1974.
Créée en tant qu’organe principal de l’OCI, la Cour Internationale Islamique de Justice se distingue par sa double vocation juridique et religieuse. Conformément à l’article 1er de son Statut, elle s’appuie de manière inaliénable sur les principes de la charia islamique, tout en respectant les dispositions de la Charte de l’OCI et de son propre cadre statutaire. Ses missions incluent la résolution des différends entre États membres, le conseil juridique et l’interprétation de conventions internationales dans une perspective islamique. La composition de la Cour, exclusivement réservée à des juges musulmans experts en charia et en droit international (article 4), reflète cette identité confessionnelle. Enfin, la charia constitue la loi fondamentale de la Cour (article 27), bien que cette dernière puisse s’inspirer de sources secondaires, telles que le droit international et les principes généraux du droit.
Bien que la CIIJ ait été fondée en 1987, son activation formelle en tant qu’organe judiciaire principal de l’OCI dépend de l’entrée en vigueur de ses statuts, conditionnée par un nombre suffisant de ratifications de ses membres. Le seuil exact de ratifications nécessaire pour que ses statuts prennent effet n’est pas officiellement défini, mais il est clair que l’adhésion de nouveaux membres, comme celle du Gabon, pourrait faire progresser ce processus.
Ce projet de loi, qui sera prochainement soumis au Parlement pour examen, ambitionne de renforcer la coopération judiciaire du Gabon avec les autres États membres de l’OCI. Cependant, cette initiative, bien qu’encourageante sur le plan diplomatique, soulève des questions fondamentales quant à sa compatibilité avec le cadre juridique gabonais, laïc et universaliste.
Cette question mérite d’être traitée avec la rigueur qu’elle impose. Il est donc crucial que constitutionnalistes et experts en droit international interviennent pour analyser cette situation en profondeur, afin de sensibiliser le Parlement et d’éviter que cette décision n’affaiblisse les principes constitutionnels.
Il est évident que tout juriste attentif pourrait aisément identifier les contradictions que ce projet soulève par rapport à l’ordre juridique interne gabonais. Une réflexion juridique approfondie, enrichie par une comparaison avec d’autres adhésions internationales, comme celles à la Cour Internationale de Justice (CIJ) ou à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’Abidjan (CCJA), permettrait de mieux cerner les tensions et contradictions potentielles qu’elle pourrait engendrer.
La neutralité religieuse face à une juridiction à connotation confessionnelle
Contrairement à des juridictions telles que la CIJ ou la CCJA, dont le caractère neutre et laïc est bien établi, la CIIJ repose explicitement sur un fondement religieux. L’article 1 du Statut de la CIIJ dispose que cette juridiction est « l’organe juridique principal » de l’OCI et qu’elle se fonde « de façon inaliénable » sur la charia islamique. Cette orientation confessionnelle est profondément ancrée, comme le confirme également l’article 27, qui établit la charia comme la « loi fondamentale » de la Cour.
Pour le Gabon, où l’article 1er alinéa 2 de la Constitution proclame la République « indivisible, laïque, démocratique et sociale », cette adhésion semble en contradiction avec un principe fondamental de l’État. La neutralité religieuse de l’État garantit la séparation entre le religieux et le politique, un fondement essentiel de la cohésion sociale dans une nation multiconfessionnelle. Une telle adhésion pourrait être perçue comme une reconnaissance implicite du droit islamique au sein de l’ordre juridique gabonais, ce qui remettrait en cause la laïcité consacrée par la Constitution.
En revanche, les juridictions comme la CIJ ou la CCJA incarnent des principes universels. La CIJ applique le droit international public dans un cadre neutre et impartial, tandis que la CCJA, organe de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), se concentre exclusivement sur les litiges économiques et commerciaux sans lien avec des convictions religieuses.
Une incompatibilité juridique manifeste : entre souveraineté nationale et suprématie internationale
Le défi posé par la loi applicable (article 27)
Selon l’article 27 du Statut de la CIIJ, la charia est la référence fondamentale, bien que la Cour puisse également s’inspirer de conventions internationales ou de principes généraux du droit. Cette hiérarchie législative pose un problème direct pour le Gabon. En effet, dans des domaines sensibles comme le droit de la famille, les règles de la charia – qui peuvent inclure des dispositions discriminatoires envers les femmes en matière de succession ou de mariage – s’opposent frontalement aux principes d’égalité consacrés par la Constitution gabonaise.
L’article 1er alinéa 3 de la Constitution garantit explicitement l’égalité de tous les citoyens sans distinction de sexe, de religion ou d’origine. Une décision de la CIIJ qui privilégierait des règles issues de la charia pourrait donc créer un précédent juridique dangereux, remettant en question les acquis en matière de droits de l’Homme au Gabon.
Les implications de la force obligatoire des décisions de la Cour (article 38)
L’article 38 du Statut dispose que les décisions de la CIIJ ne lient que les parties en litige. Cependant, selon l’article 166 de la Constitution gabonaise, les traités ou accords internationaux ratifiés par le Gabon ont une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve que l’État signataire émette quelques réserves. Cette disposition pourrait donc, en théorie, permettre à une décision de la CIIJ de prévaloir sur une loi gabonaise, même si cette décision va à l’encontre des principes constitutionnels de laïcité et d’égalité. Ce risque est d’autant plus préoccupant dans un contexte où la charia, mentionnée comme « loi fondamentale » de la Cour, est incompatible avec le droit mixte en vigueur au Gabon.
Une composition discriminatoire en contradiction avec l’égalité des citoyens
L’article 4 du Statut de la CIIJ impose que les juges soient des musulmans, ressortissants des pays membres de l’OCI, et experts en charia. Ce critère exclut de facto tout citoyen gabonais non musulman d’une éventuelle représentation au sein de cette juridiction. Cette clause entre en contradiction avec l’article 1er alinéa 3 de la Constitution gabonaise, qui consacre l’égalité de tous les citoyens et interdit toute discrimination fondée sur la religion. En comparaison, la CIJ et la CCJA ne font aucune distinction fondée sur la religion dans la sélection de leurs juges, ce qui garantit leur impartialité et leur universalité.
Perception publique et risques politiques
L’intégration du Gabon à des juridictions comme la CIJ ou la CCJA a été perçue comme un moyen de renforcer l’État de droit et de promouvoir la sécurité juridique, tant pour les citoyens que pour les investisseurs internationaux. Ces juridictions incarnent des valeurs de neutralité et d’universalité, qui trouvent un écho favorable auprès de l’opinion publique et des partenaires du Gabon.
En revanche, l’adhésion à la CIIJ risque d’être interprétée comme une inflexion vers une gouvernance influencée par des considérations religieuses. Dans un pays où cohabitent plusieurs confessions religieuses, une telle adhésion pourrait provoquer des tensions sociopolitiques, certains citoyens pouvant percevoir cette démarche comme une partialité de l’État en faveur d’une religion spécifique. Ce risque est d’autant plus grand que les principes de la CIIJ, notamment en matière de loi applicable et de composition, ne garantissent pas une approche neutre et équitable.
Un exemple hypothétique illustre les tensions potentielles : imaginons qu’un différend en matière de succession soit porté devant la CIIJ, impliquant un ressortissant gabonais. Si la Cour applique des principes issus de la charia, tels que la part différenciée d’héritage entre hommes et femmes – dont l’interprétation tirée du Coran diffère d’un pays musulman à l’autre –, la décision entrerait en conflit avec les dispositions du Code civil gabonais, qui consacre une stricte égalité entre héritiers. Une telle situation pourrait susciter des contestations publiques et affaiblir la confiance des citoyens dans les institutions judiciaires nationales.
Conclusion : vers une réflexion approfondie et une concertation nationale
L’adhésion du Gabon au Statut de la Cour Internationale Islamique de Justice soulève des enjeux complexes, à la croisée des impératifs diplomatiques, des principes constitutionnels et de la cohésion sociale. Si cette initiative témoigne d’une volonté de renforcer les liens avec les membres de l’Organisation de la Coopération Islamique, elle pourrait également engendrer des tensions juridiques et sociopolitiques, en particulier sur des questions aussi fondamentales que la laïcité, l’égalité et la souveraineté.
Dès lors, alors que ce projet de loi sera soumis à l’examen du Parlement, il est impératif que les parlementaires mesurent pleinement les implications d’une telle adhésion. Il leur revient de s’assurer que cette décision ne fragilise ni les principes fondamentaux consacrés par la Constitution gabonaise, ni l’unité nationale dans un pays riche de sa diversité culturelle et religieuse.
Les parlementaires devront également veiller à ce que cette démarche soit précédée d’un véritable débat national, impliquant toutes les parties prenantes – citoyens, juristes, représentants religieux et acteurs de la société civile – afin de garantir une décision éclairée et partagée. Seule une réflexion approfondie permettra de préserver l’intégrité des institutions tout en maintenant l’équilibre entre les engagements internationaux du Gabon et ses valeurs républicaines.
Si le Parlement venait à adopter ce projet de loi, il serait essentiel que la Cour constitutionnelle assure son rôle de contrôle de conformité à la Constitution, conformément aux articles 114 et 115 de la Constitution. Ces dispositions permettent à la Cour d’examiner la constitutionnalité des lois avant leur promulgation : un contrôle obligatoire pour les lois organiques ou un contrôle éventuel pour les lois ordinaires. En cas d’inconstitutionnalité, le Parlement disposerait d’un délai de trente jours pour corriger la loi. Ce mécanisme garantirait le respect des principes fondamentaux de la Constitution et préserverait l’intégrité des institutions républicaines.




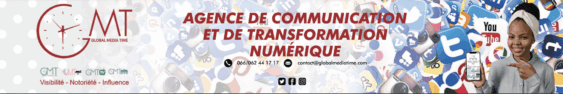




![[#LeCanapéRouge] #Teaser Gildas Ndzengue Mbomba, Président de l'AGUB
ce Lundi 23 Février 2026 à 21h00, face caméra sur GMTtv
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧
📲 066441717 📞 011775663
📬 contact@gabonmediatime.com
𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 :
🔗 https://lc.cx/9dgPhl
🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞
⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬.
#GMT
#Gabon](https://gabonmediatime.com/wp-content/plugins/feeds-for-youtube/img/placeholder.png)
Qui est l’auteur de cet article svp?