Touré Blamassi : «La traite des êtres humains est devenue un business transnational financé par des réseaux terroristes»

Lauréat ivoirien de l’Initiative Marianne pour les droits de l’Homme 2025, Touré Blamassi s’est imposé comme une voix montante dans la lutte contre la traite des personnes et la défense des migrants en Afrique du Nord. Basé à Tunis, acteur dans le film Promis le ciel présenté au Festival de Cannes 2025 et primé à Angoulême, il porte un regard lucide sur les dérives migratoires, la responsabilité des États et les nouveaux visages de l’exploitation humaine. Entretien.
Gabon Media Time : Vous êtes l’un des 15 lauréats mondiaux de l’Initiative Marianne pour les droits de l’Homme. Pouvez-vous nous présenter ce programme ?
Touré Blamassi : L’Initiative Marianne est un programme piloté par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères. Chaque année, la France sélectionne 15 défenseurs des droits humains à travers le monde sur dossier, en fonction de leur engagement et de leur impact. C’est un peu le même esprit que les programmes Mandela Washington Fellowship ou YALI initiés par Barack Obama. Les lauréats séjournent en France pendant six mois, bénéficient d’une bourse et d’un accompagnement. On y apprend à mieux comprendre les mécanismes internationaux de défense des droits de l’Homme, à développer des projets concrets, mais aussi à construire un réseau mondial. J’ai pu ainsi participer à plusieurs missions, notamment à Bruxelles, Genève et Strasbourg.
Dans le cadre de ce programme, vous avez porté un projet sur la lutte contre la traite des personnes. De quoi s’agit-il concrètement ?
Oui, j’ai obtenu un financement pour mettre en œuvre un projet axé sur la lutte contre la traite des êtres humains, notamment au Maroc et en Côte d’Ivoire. Ce projet vise trois objectifs principaux : l’identification des victimes, leur accompagnement psychologique et social, et la sensibilisation des communautés sur les dangers des routes migratoires. Il ne s’agit pas d’empêcher les gens de partir — partir est un droit —, mais de les aider à partir de manière sûre, informée et digne. Trop de jeunes, souvent mineurs, tombent entre les mains de passeurs sans scrupules. En Tunisie, par exemple, nous avons recensé plus de 1 200 potentielles victimes de traite en 2024, dont près de 20 % étaient des mineurs non accompagnés, venus principalement de Guinée, de Sierra Leone et de Gambie.
Vous évoquez des routes migratoires de plus en plus dangereuses. Que révèlent vos travaux de terrain ?
Les routes migratoires ont totalement changé. Jusqu’en 2017, la majorité des migrants arrivaient en Tunisie par avion, souvent en situation régulière. Aujourd’hui, la plupart entrent clandestinement par les frontières terrestres libyenne ou algérienne, contrôlées en partie par des réseaux criminels.
Plus grave encore, nos recherches montrent que certains de ces réseaux sont désormais liés à des groupes djihadistes au Sahel. Ces groupes utilisent la traite humaine comme source de financement, au même titre que le trafic de drogue. Ils profitent des zones de non-droit — comme Tessalit ou Kidal au Mali — pour établir des couloirs d’exploitation. C’est une réalité glaçante : la migration irrégulière est devenue une économie parallèle, avec ses acteurs, ses investisseurs et ses victimes.
En Afrique centrale, notamment au Gabon, la question migratoire est souvent perçue comme lointaine. Est-ce réellement le cas ?
Pas du tout. Le Gabon est à la fois pays d’accueil et pays de transit. On parle souvent de migration vers l’Europe, mais il existe aussi une migration vers le Gabon, parfois irrégulière, qui crée d’autres formes d’exploitation.
Et puis, il y a aussi des Gabonais installés en Tunisie ou au Maroc, qui subissent les mêmes discriminations que d’autres subsahariens : expulsions arbitraires, violences, ou travail informel non rémunéré. La traite ne se limite pas à la traversée de la Méditerranée — elle commence bien avant, dès le moment où des réseaux organisés promettent un avenir illusoire à des jeunes désespérés.
Votre parcours mêle activisme, recherche et… cinéma. Comment ces univers se rejoignent-ils ?
L’art est une forme de militantisme. J’ai joué dans le film Promis le ciel, aux côtés d’Aïssa Maïga, une actrice franco-sénégalaise. Le film parle d’adoption, mais aussi des réalités migratoires et des persécutions vécues sur les routes d’exil. Il a été présenté au Festival de Cannes 2025 et primé au Festival d’Angoulême. Ce projet m’a permis de mettre en lumière ce que les chiffres ne traduisent pas toujours : la douleur, la peur, la dignité blessée. Derrière chaque migrant, il y a une histoire, un rêve, une vie. Et tant que ces vies seront broyées par des systèmes d’exploitation, notre combat pour les droits humains ne sera pas terminé.
Comment envisagez-vous la suite de votre engagement après l’Initiative Marianne ?
Le programme s’achève, mais la mission continue. Nous avons créé un réseau panafricain d’anciens lauréats pour mutualiser nos actions. Je travaille désormais avec la Fondation Lafayette-Dimbo, dirigée par le philosophe camerounais Achille Mbembe, sur des projets liés à la gouvernance démocratique et à la mobilité humaine.
Mon objectif, c’est de créer des passerelles entre les défenseurs africains des droits humains, d’encourager la coopération entre États et d’impliquer davantage la jeunesse. Parce que la traite, la migration, la pauvreté et la violence sont les symptômes d’un même mal : le manque de justice sociale.




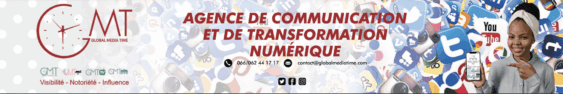





GMT TV
[youtube-feed feed=2]