Ali Akbar Onanga Y’Obegue : « pourquoi les élections du 27 septembre doivent etre annulées »

Le 30 août 2023, le Gabon a basculé dans une nouvelle ère politique à travers un coup d’État militaire qui mit fin à l’ancien régime. Ce putsch, présenté comme un acte de salut public, trouvait sa légitimation dans la dénonciation d’élections présidentielles truquées, considérées comme une insulte à la démocratie. Les auteurs de la prise de pouvoir se sont alors engagés devant la Nation et devant le monde à mettre fin aux mascarades électorales, à instaurer la transparence et à organiser, à l’issue de la transition, des élections libres, équitables et crédibles. Leur légitimité reposait exclusivement sur cette promesse : faire de la sincérité du suffrage la pierre angulaire du nouvel édifice démocratique.
Deux ans plus tard, les élections législatives et locales du 27 septembre 2025 ont démontré que ces engagements n’ont pas été tenus. Loin de constituer une avancée vers la refondation démocratique, elles se sont révélées plus chaotiques, plus frauduleuses et plus arbitraires encore que celles de 2023. Ce paradoxe est insoutenable : un régime né au nom de la lutte contre la fraude électorale est devenu l’organisateur de la fraude la plus massive de l’histoire politique du pays. Dès lors, la question qui se pose est limpide : si les irrégularités de 2023 justifiaient un coup d’État, que justifient alors celles, plus graves encore, de 2025 ? Cette contradiction mine la crédibilité du processus de transition et ruine la confiance du peuple dans ses institutions.
I. LA CONTRADICTION HISTORIQUE ET POLITIQUE DU POUVOIR ISSU DU COUP D’ÉTAT
En août 2023, l’argument central des militaires pour s’emparer du pouvoir fut l’organisation d’élections entachées d’irrégularités massives. C’est au nom de la transparence et du respect de la souveraineté populaire qu’ils suspendirent l’ordre constitutionnel, promettant de rendre au peuple son droit à choisir librement ses représentants. La Constitution du 19 décembre 2024 a d’ailleurs réaffirmé ces principes fondamentaux en disposant que la souveraineté appartient au peuple, qu’elle s’exerce par l’élection, et que le suffrage est universel, égal et secret. Ces principes n’étaient pas de simples proclamations : ils constituaient la boussole de la transition.
Or, deux ans après, les promesses se sont envolées. Les élections du 27 septembre ont donné lieu à des pratiques qui rappellent, mais aggravent encore, celles de l’ancien régime : bourrages d’urnes, manipulation du fichier électoral, usage massif des moyens de l’État au profit du parti présidentiel, intimidation des électeurs, résultats incohérents, falsification des procès-verbaux, proclamations fractionnées. L’ironie est amère : le régime actuel, qui avait fondé sa légitimité sur la condamnation d’une fraude, reproduit à son tour les mêmes travers, en les portant à un degré de cynisme encore plus poussé.
II. LES VIOLATIONS JURIDIQUES ET LES PREUVES MATÉRIELLES DE LA FRAUDE
Le scrutin du 27 septembre 2025 n’a pas seulement été mal organisé : il a été marqué par des fraudes que le Code électoral qualifie expressément d’irrégularités entraînant la nullité.
Le fichier électoral a été dénoncé comme truffé de doublons et de noms de personnes décédées, permettant les votes multiples et les manipulations massives.
Le déroulement même du vote a été vicié par l’absence de bulletins pour certains candidats, par la circulation de bulletins non authentifiés et par des bourrages d’urnes documentés par vidéos. Ces faits violent les dispositions du Code imposant l’usage exclusif de bulletins officiels sécurisés et l’unicité du vote. La conséquence légale est la nullité des votes concernés et, en cas de généralisation comme ici, la nullité du scrutin tout entier.
Le dépouillement et la centralisation des résultats ont ensuite donné lieu à des falsifications manifestes : procès-verbaux réécrits, chiffres corrigés entre les bureaux et la Commission centrale, signatures falsifiées. Le Code impose pourtant que les procès-verbaux soient signés par les membres du bureau et les scrutateurs ; leur altération constitue une fraude grave qui justifie l’annulation des résultats de la circonscription.
Mais plus accablantes sont les aberrations arithmétiques consignées dans les résultats officiels. Dans une circonscription, le ministre de l’Intérieur a annoncé fièrement que 4 515 votants avaient été enregistrés pour seulement 3 237 inscrits. Soit 1 278 électeurs surnuméraires, représentant un taux de participation mathématique de 139 %. Ces chiffres impossibles ne peuvent s’expliquer ni par une erreur matérielle ni par une simple négligence. Ils sont la preuve irréfutable d’une fraude massive et organisée. Ils révèlent la falsification systématique des procès-verbaux et la fabrication de résultats artificiels. Et comme si cette imposture ne suffisait pas, le ministre de l’Intérieur, en direct à la télévision, a laissé transparaître son propre doute en s’interrogeant à voix haute sur les chiffres qu’il proclamait. Quand même l’autorité chargée d’organiser le scrutin doute publiquement de la validité de ses propres résultats, comment demander au peuple de leur accorder le moindre crédit ?
Plus grave encore, la proclamation des résultats a été effectuée en violation de l’article 160, qui impose la simultanéité et la transparence de la publication. Or, les résultats des législatives ont été proclamés en deux temps, les 28 et 29 septembre, et ceux des locales pourtant tenues le même jour que les législatives n’ont été rendus publics que le 3 octobre. Cette violation ouvre la porte à des corrections clandestines et à des manipulations, et entraîne de plein droit la nullité des résultats.
Ainsi, chacune des fraudes constatées le 27 septembre correspond à une hypothèse expressément prévue par le Code électoral : manipulation du fichier, introduction d’électeurs frauduleux, usage de bulletins non conformes, bourrages d’urnes, falsification des procès-verbaux, proclamation fractionnée, corruption par les moyens de l’État. Toutes ces infractions, prises isolément, suffiraient à entraîner l’annulation du scrutin. Combinées, elles ne laissent place à aucun doute : l’ensemble du processus électoral est entaché de nullité et doit être annulé, conformément aux dispositions mêmes du droit électoral gabonais.
À toutes ces irrégularités manifestes s’ajoute une difficulté juridique insurmontable, directement issue de la réforme du Code électoral de 2025. L’article 214 impose en effet que le second tour se tienne le quatorzième jour après l’annonce des résultats du premier tour par le Ministre de l’Intérieur. Or, cette disposition entre frontalement en contradiction avec le rôle de la Cour constitutionnelle, qui reçoit les recours et doit statuer sur les contestations avant de proclamer les résultats définitifs.
Dans le cas présent, les recours sont ouverts jusqu’au 9 octobre, alors que le second tour est prévu le 11 octobre. Une telle situation génère des incohérences graves : un candidat initialement écarté peut être réhabilité par la Cour constitutionnelle seulement deux jours avant le scrutin, sans avoir eu le temps de mener campagne ; inversement, un candidat déclaré qualifié peut être invalidé après avoir mobilisé ses électeurs.
L’ancien Code électoral, plus rationnel et respectueux de la hiérarchie des normes, prévoyait que le second tour ne puisse avoir lieu qu’après la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle (ancien article 114). Ce système offrait la garantie que la compétition électorale démarre sur des bases claires, après épuisement du contentieux. En rompant avec cette logique, le nouveau Code a introduit une faille juridique majeure, qui compromet la sincérité du scrutin et fragilise son acceptabilité politique.
Ainsi, indépendamment des fraudes déjà relevées, cette contradiction interne du nouveau dispositif électoral constitue en elle-même un motif suffisant pour exiger non seulement l’annulation des élections du 27 septembre, mais aussi une révision urgente du Code électoral, afin de rétablir une séquence cohérente entre contentieux et organisation des scrutins.
III. LES CONSÉQUENCES POLITIQUES ET LA NÉCESSITÉ D’ANNULER LES ÉLECTIONS
D’un point de vue politique, le problème est tout aussi grave. Un parlement issu de telles élections n’a aucune légitimité. Il pourra siéger, voter des lois, prendre des décisions, mais jamais il ne sera reconnu par le peuple comme l’expression de sa volonté. Or, la légitimité est la clé de voûte de toute institution démocratique : sans elle, la loi devient un instrument de domination plutôt qu’une règle commune, et les décisions politiques ne sont plus que des décrets imposés par la force. L’histoire africaine et mondiale a montré que des institutions bâties sur la fraude sont des bombes à retardement : elles accumulent la frustration, attisent la colère et finissent par exploser en crises sociales et politiques.
Il est important de rappeler à ce stade que ceux qui, en 2023, avaient applaudi le coup d’État au nom de la lutte contre la fraude électorale portent aujourd’hui une lourde responsabilité morale et politique. Nous leur disions alors que les crises électorales doivent se régler par le droit et par le débat politique, et non par les armes. Ils ont préféré soutenir un pouvoir militaire qui promettait monts et merveilles. Aujourd’hui, les mêmes découvrent avec effroi que ce pouvoir qu’ils ont cautionné est devenu l’organisateur d’une fraude électorale encore plus grave. Leurs dénonciations actuelles ne sont que des larmes de crocodile : ils ne peuvent feindre la surprise, car ils ont sciemment légitimé un régime dont les pratiques liberticides étaient prévisibles. Qu’ils se taisent donc, ou qu’ils assument leur part de responsabilité dans la catastrophe actuelle. Le peuple gabonais, lui, ne doit pas se laisser tromper par ces repentirs tardifs.
En réalité, le scrutin du 27 septembre 2025 n’est pas seulement un échec organisationnel, mais il est également une agression délibérée contre la démocratie gabonaise. C’est une forfaiture qui viole à la fois la Constitution et le Code électoral, qui bafoue le principe de souveraineté populaire, qui ridiculise le droit et qui insulte l’intelligence collective. Les conséquences de sa validation seraient désastreuses. Sur le plan institutionnel, elle installerait des organes sans légitimité, incapables de gouverner sereinement. Sur le plan social, elle creuserait le fossé de la défiance entre les citoyens et leurs dirigeants, alimentant une instabilité chronique. Sur le plan démocratique, elle consacrerait la fraude comme mode normal de conquête et d’exercice du pouvoir, hypothéquant l’avenir du pays pour des décennies.
Il faut le dire avec force, les institutions issues de ces élections frauduleuses ne peuvent prétendre représenter le peuple. Un parlement élu sur la base de telles irrégularités n’aurait aucune légitimité, même s’il bénéficie formellement d’une reconnaissance légale. La conséquence serait double : d’un côté, des institutions discréditées, incapables de gouverner efficacement ; de l’autre, une rupture de confiance profonde entre les citoyens et leurs dirigeants, source d’instabilité chronique.
Valider ce scrutin créerait en outre un précédent catastrophique : il consacrerait la fraude comme méthode normale de conquête et de conservation du pouvoir. Ce précédent hypothéquerait l’avenir démocratique du Gabon pour des décennies et créerait les conditions d’un cycle sans fin d’instabilité. Si une fraude électorale a déjà justifié un coup d’État en 2023, rien n’empêcherait qu’une nouvelle fraude, demain, justifie une nouvelle rupture brutale de l’ordre institutionnel.
CONCLUSION
Il ne reste donc qu’une issue raisonnable, cohérente et conforme au droit : l’annulation pure et simple des élections du 27 septembre 2025. Cette annulation ne serait pas une faveur accordée à l’opposition, encore moins une manœuvre politicienne : elle serait la conséquence logique des principes inscrits dans la Constitution et dans le Code électoral. Elle serait la condition nécessaire pour redonner un peu de crédibilité au processus de transition. Elle permettrait de relancer la marche du pays vers de véritables élections libres et transparentes, seules capables de fonder des institutions respectées et durables.
Mais si, malgré l’évidence des fraudes et l’exigence du droit, le pouvoir en place persistait à refuser d’annuler ces élections, il resterait encore aux acteurs politiques une arme de dernier recours. Ceux dont les candidats sont qualifiés pourraient envisager, par sens de responsabilité nationale, de se retirer de la compétition, à l’instar du président de l’EPG. Un tel geste, fort et symbolique, empêcherait la tenue d’un second tour dont l’unique fonction serait de valider un scrutin déjà discrédité.
En bloquant ainsi la tenue de ce second tour, ils empêcheraient la validation d’un scrutin catastrophique pour la démocratie et l’État de droit. Un tel geste de courage et de cohérence aurait valeur d’acte fondateur : il montrerait que l’opposition n’est pas condamnée à subir, mais qu’elle est capable d’imposer, par la dignité et la discipline, le respect des principes démocratiques.
Le pouvoir gabonais est aujourd’hui à un carrefour historique. Il peut choisir le courage, celui de reconnaître ses fautes, de tirer les leçons de cet échec et de réorganiser des élections sincères. Ou il peut choisir l’entêtement, celui de valider une fraude éhontée et d’assumer la responsabilité d’un passage en force qui trahirait définitivement les promesses de refondation démocratique. Mais il doit comprendre que dans un pays où la fraude électorale a déjà provoqué un coup d’État, persévérer dans cette voie n’est pas seulement une erreur : c’est une faute historique aux conséquences potentiellement irréversibles pour la stabilité et l’avenir du Gabon.
Ali Akbar ONANGA Y’OBEGUE
Docteur en Droit,
Enseignant à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de l’Université Omar Bongo de Libreville,
Secrétaire Général du Parti Démocratique Gabonais,
Ancien Ministre.




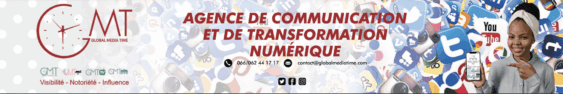




GMT TV