Gabon : le droit à réparation, grande oubliée de la justice pénale

Alors que les sessions criminelles se déroulent dans tout le pays, le silence autour de l’indemnisation des victimes de détentions abusives illustre une faille béante de l’État de droit. Derrière chaque acquittement, il y a une vie brisée… et un État qui se dérobe à sa responsabilité.
Les prétoires du Gabon résonnent ces jours-ci de verdicts qui scellent des destins. Parmi eux, certains libèrent des hommes et des femmes après des années de détention préventive… pour rien. Dix ans parfois, derrière les barreaux, sans jugement, avant un non-lieu ou un acquittement. Des innocents privés de liberté, ruinés, brisés psychologiquement. Pourtant, le Code de procédure pénale, aux articles 146 à 148, encadre précisément leur droit à réparation. Un droit qui, dans la pratique, se heurte à un mur d’indifférence et de mutisme administratif.
Une loi claire… sur le papier
L’article 146 est limpide : toute personne détenue injustement a droit à une indemnisation lorsque la justice reconnaît son innocence par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement définitif. L’État, responsable du préjudice, doit réparer tant le dommage matériel que moral.
Pour instruire ces demandes, une commission spéciale siège à la Cour de cassation. Elle réunit son Premier président, un magistrat du Conseil d’État, et un représentant du ministère du Budget. Le procureur général près la Cour de cassation y intervient comme ministère public. Autrement dit, l’arsenal existe. Mais encore faut-il qu’il soit appliqué.
Une procédure verrouillée et méconnue
L’article 147 fixe un délai de six mois pour déposer la demande. Passé ce délai, le droit à indemnisation s’évapore. Les audiences, elles, se tiennent à huis clos, et la décision – non motivée – n’est pas susceptible de recours. Une opacité qui heurte de plein fouet l’exigence de transparence judiciaire.
Pire encore : la plupart des détenus acquittés ignorent jusqu’à l’existence de ce droit. Aucun dispositif d’information n’est prévu par l’État, aucun accompagnement juridique n’est offert. Ceux qui sortent des geôles après des années d’innocence présumée ne savent pas qu’ils peuvent demander réparation.
Une justice réparatrice qui n’existe que dans les textes
L’article 148 prévoit pourtant la gratuité de la procédure, à la charge de l’État, et autorise même des poursuites contre les auteurs de fausses dénonciations. Une disposition dissuasive, censée prévenir les abus qui mènent à ces détentions iniques.
Mais sur le terrain, les réalités sont tout autres. À Libreville, Port-Gentil ou Franceville, des hommes blanchis après dix ans de détention préventive errent aujourd’hui sans ressources, sans soins, et sans le moindre geste de l’État. Les excuses, elles, ne figurent même pas au programme.
L’impératif d’une réforme crédible
Dans un État de droit digne de ce nom, réparer une erreur judiciaire n’est pas une faveur : c’est une obligation. Le Gabon ne peut plus se contenter de libérer des innocents et de les renvoyer à la rue sans compensation.
Trois urgences s’imposent : Informer massivement les justiciables de leurs droits à réparation, dès la notification du jugement; Publier et motiver les décisions d’indemnisation pour garantir transparence et confiance; Créer un fonds dédié, financé par l’État, pour assurer des réparations rapides et justes.
La maturité d’un système judiciaire ne se mesure pas seulement à la rigueur des peines infligées aux coupables, mais aussi à sa capacité à réparer ses propres fautes. En laissant dans l’ombre le droit à indemnisation, la justice gabonaise se prive d’un de ses leviers les plus puissants pour restaurer la confiance des citoyens. Il est temps de passer des textes aux actes.




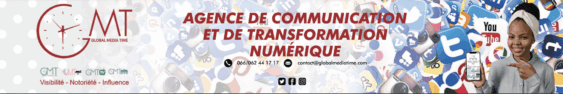





GMT TV
[youtube-feed feed=2]