Affaire Harold Leckat : quand l’erreur juridique révèle l’instrumentalisation politique

L’arrestation de M. Harold Leckat à l’aéroport Léon Mba le 15 octobre 2025, telle que rapportée par diverses sources, soulève des questions juridiques fondamentales qui dépassent largement la personne de l’intéressé. Indépendamment de toute appréciation sur le fond du dossier ou la véracité des allégations portées, cette affaire révèle des dysfonctionnements procéduraux si graves qu’ils interrogent la nature même de la transition que traverse notre pays.
Une qualification pénale juridiquement insoutenable
Selon les éléments d’information disponibles, nous sommes face à un contrat commercial de prestation de services conclu en septembre 2020 entre une société privée, Gabon Media Time, et un établissement public, la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce contrat portant sur un montant de 10,9 millions de FCFA mensuels, a été renouvelé jusqu’en 2023, et a même été maintenu pendant six mois par les nouvelles autorités de la CDC après leur prise de fonction. Il s’agirait donc, en apparence, d’une relation contractuelle classique entre deux personnes morales juridiquement constituées.
Or, l’enquête a choisi de qualifier ces faits de « détournement de deniers publics ». Cette qualification est juridiquement inadéquate. Si les faits sont avérés tels que rapportés, nous sommes face à une erreur manifeste de droit qui révèle soit une méconnaissance des règles fondamentales du droit pénal, soit une instrumentalisation délibérée de la procédure pénale.
Le détournement de deniers publics, infraction prévue et réprimée par notre Code pénal, suppose nécessairement que l’auteur revête la qualité d’agent public, ordonnateur ou comptable public, ayant la charge de gérer ou de manier des fonds publics. Cette qualification pénale vise à sanctionner la violation du devoir de probité qui incombe aux dépositaires de l’autorité publique dans la gestion des deniers de l’État. Elle protège la chose publique contre ceux qui, investis d’une mission de service public, trahissent la confiance placée en eux.
M. Harold Leckat, à supposer qu’il soit uniquement dirigeant d’une société privée ayant contracté avec un établissement public, ne saurait être qualifié d’agent public au sens du droit pénal. Il n’est ni ordonnateur, ni comptable public. Il ne gère pas de fonds publics en qualité d’agent de l’État, mais perçoit des sommes en exécution d’un contrat commercial passé avec son entreprise. Cette distinction est au cœur du droit pénal : on ne peut être poursuivi que pour des infractions dont on remplit les éléments constitutifs.
La jurisprudence constante en matière de détournement de deniers publics exige un élément moral spécifique, à savoir la conscience, pour l’agent public, de porter atteinte au patrimoine public dont il a la garde. Or, un contractant privé qui perçoit des sommes en vertu d’un contrat ne peut, par définition, être animé de cette intention frauduleuse, puisqu’il agit dans le cadre d’un engagement contractuel librement consenti par les deux parties.
Le choix inexplicable de la voie pénale
Sous réserve de la véracité des faits tels que rapportés, ce différend relèverait en toute logique juridique d’autres juridictions que le juge pénal. Si la CDC estimait que les prestations contractuellement prévues n’avaient pas été correctement exécutées, elle disposait des recours contractuels classiques devant le tribunal de commerce : mise en demeure du cocontractant, résiliation pour faute, action en résolution du contrat pour inexécution, demande de dommages-intérêts pour préjudice subi. C’est le contentieux commercial ordinaire, celui qui régit quotidiennement les relations d’affaires entre entreprises.
Si la CDC considérait avoir versé des sommes sans contrepartie réelle, elle pouvait agir devant les juridictions civiles sur le fondement de l’enrichissement sans cause, action classique permettant d’obtenir la restitution de sommes versées indûment, ou encore sur le fondement de la répétition de l’indu, ou même du dol contractuel si elle estimait avoir été victime de manœuvres lors de la conclusion du contrat.
Cette criminalisation d’un différend qui relève manifestement du contentieux civil ou commercial constitue un détournement de procédure qui porte atteinte aux principes fondamentaux du droit. Le choix de la voie pénale avec la qualification de « détournement de deniers publics » constitue donc, en l’état des éléments connus, soit une méconnaissance des règles de compétence juridictionnelle, soit une instrumentalisation délibérée de la procédure pénale.
Une arrestation aux allures de mise en scène
En tout état de cause, les modalités de l’arrestation et de la détention de M. Harold Leckat, telles que rapportées, soulèvent de graves interrogations au regard des principes fondamentaux de la procédure pénale et des droits de la défense. Selon les informations disponibles, M. Harold Leckat revenait d’une formation professionnelle à Montpellier, financée par l’Union européenne dans le cadre du programme « Libreville-Montpellier-Médias & Démocratie ». Il avait informé la Direction Générale des Recherches de son absence et transmis ses justificatifs. Une audition était convenue pour le 16 octobre à 9 heures, soit le lendemain de son retour. L’arrestation est néanmoins intervenue le 15 octobre à 19 heures, sur le tarmac de l’aéroport, en présence de son épouse.
Si ces éléments sont avérés, plusieurs questions se posent avec une acuité particulière. Le principe de proportionnalité, qui gouverne l’ensemble de la procédure pénale, impose que les mesures coercitives ne soient employées que lorsqu’elles sont strictement nécessaires. Une personne connue, joignable, chef d’entreprise établi, ayant confirmé sa disponibilité pour une audition le lendemain, justifiait-elle une interpellation immédiate sur le tarmac d’un aéroport international? Cette question interroge la proportionnalité même de la mesure.
Les conditions d’une arrestation doivent respecter la dignité de la personne, sauf circonstances exceptionnelles telles qu’un risque de fuite avéré, une dangerosité caractérisée, ou une nécessité impérieuse de préservation des preuves. Aucun de ces éléments ne semble caractérisé en l’espèce. M. Harold Leckat n’est pas un individu clandestin, il n’a pas de casier judiciaire rapporté, il revenait d’une formation officielle financée par un partenaire international majeur du Gabon. L’arrestation spectaculaire sur un tarmac d’aéroport, devant des témoins, relève davantage de la mise en scène que de la nécessité procédurale.
Des conditions de détention qui déshonorent la justice
Par ailleurs, les déclarations attribuées à M. Harold Leckat devant le procureur de la République le 17 octobre, selon lesquelles il aurait été « contraint de dormir sur une chaise, menotté toute la nuit », si elles sont avérées, constitueraient une violation grave et multiple de normes fondamentales. Elles violeraient l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants, et de manière générale garantit le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, et à laquelle le Gabon est partie. Elles violeraient l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, connu sous le nom de Règles Nelson Mandela, qui fixent des standards internationaux contraignants.
Je tiens à le dire avec la force du droit : même à supposer que les faits reprochés à M. Harold Leckat soient établis, même s’il était coupable de tout ce dont on l’accuse, aucune infraction ne saurait justifier des conditions de détention contraires à la dignité humaine. Ce principe est absolu et ne souffre aucune exception. La sanction éventuelle est celle prononcée par le juge après un procès équitable, non celle infligée durant la procédure par des conditions de détention inhumaines. Un État de droit se reconnaît à la manière dont il traite les personnes poursuivies, pas seulement à la manière dont il traite les innocents.
Le silence du parquet sur ces allégations de mauvais traitements est particulièrement préoccupant. Le procureur de la République, en sa qualité de gardien de la procédure pénale et de garant des libertés individuelles, se devait de diligenter immédiatement une enquête sur ces faits graves. Son silence équivaut à une forme de complicité passive. Lorsqu’un justiciable dénonce publiquement, devant le procureur lui-même, des conditions de détention inhumaines, et que cette dénonciation ne suscite aucune réaction, aucune vérification, aucune sanction, c’est toute la chaîne judiciaire qui se trouve discréditée.
La prolongation de la garde à vue comme aveu de faiblesse
Au demeurant, la prolongation de la garde à vue de 72 heures supplémentaires, si elle n’est pas justifiée par des éléments probatoires nouveaux et substantiels, peut s’analyser comme une mesure dilatoire destinée à compenser la faiblesse du dossier, à exercer une pression psychologique sur la personne gardée à vue, ou à organiser une mise en scène médiatique. Un dossier solidement étayé ne nécessite généralement pas de telles prolongations.
Dans la pratique judiciaire, les prolongations multiples de garde à vue sont souvent le signe d’une enquête qui cherche désespérément des éléments à charge, ou qui tente de briser psychologiquement la personne poursuivie pour obtenir des aveux. Cette pratique est contraire à tous les principes du procès équitable. Elle transforme la garde à vue, qui devrait être une mesure d’investigation, en instrument de pression psychologique.
La coïncidence troublante avec la liberté de la presse
Sans préjuger des motivations réelles des poursuites, il est impossible d’ignorer la coïncidence troublante entre la ligne éditoriale critique de Gabon Media Time à l’égard du pouvoir en place, l’arrestation spectaculaire de son directeur au retour d’une formation européenne sur les médias et la démocratie, et le calendrier de cette arrestation intervenue un mois seulement après la visite officielle du Secrétaire général de Reporters Sans Frontières au Gabon.
Cette coïncidence, même si elle était purement fortuite, crée une apparence de répression de la liberté d’expression qui ternit l’image internationale du Gabon, contredit les progrès affichés en matière de liberté de la presse avec le passage de la 56ème à la 41ème place au classement mondial de RSF, et envoie un signal négatif aux partenaires internationaux, notamment l’Union européenne qui a financé la formation dont M. Leckat revenait au moment de son arrestation.
Même à supposer que les poursuites soient parfaitement fondées en droit, même si M. Harold Leckat était coupable de tout ce dont on l’accuse, la perception d’une instrumentalisation de la justice à des fins de répression de la presse libre demeure dommageable pour le Gabon. Cette perception risque de transformer une affaire judiciaire, quelle qu’en soit l’issue, en scandale diplomatique ayant des répercussions sur les relations avec nos partenaires internationaux.
Les questions sans réponse
Au terme de cette analyse, plusieurs questions demeurent sans réponse satisfaisante, et ces questions ne portent pas sur la culpabilité ou l’innocence de M. Harold Leckat. Elles portent sur la régularité de la procédure, le respect des droits fondamentaux, et l’égalité de traitement devant la justice pénale.
Pourquoi choisir la voie pénale avec une qualification juridiquement inadaptée, alors que le contentieux civil ou commercial offrait des voies de recours appropriées et juridiquement fondées?
Pourquoi une arrestation spectaculaire alors que la personne était joignable, connue, établie, et avait convenu d’une audition volontaire le lendemain?
Pourquoi des conditions de détention inhumaines, si elles sont avérées, alors même que la présomption d’innocence devrait prévaloir à ce stade de la procédure?
Pourquoi cette affaire portant sur 460 millions de FCFA sur trois ans avec prestations contractuelles documentées fait-elle l’objet d’un tel déploiement de force, quand d’autres dossiers impliquant des milliards de FCFA sans contrepartie apparente, documentés par des rapports officiels, ne connaissent pas le même traitement judiciaire? Cette question interroge l’égalité devant la justice pénale et suggère une sélectivité des poursuites contraire aux principes démocratiques.
Un appel solennel à la vigilance démocratique
En qualité de juriste attaché aux principes de l’État de droit, en qualité de citoyen épris de liberté, en qualité d’homme politique engagé pour la promotion de la démocratie, je ne peux rester silencieux face à ces dysfonctionnements manifestes.
Même à supposer que M. Harold Leckat soit coupable des faits qui lui sont reprochés, la qualification juridique retenue apparaît erronée et le choix de la juridiction pénale inapproprié. Cette erreur n’est pas un détail technique, elle révèle soit une incompétence inquiétante, soit une instrumentalisation délibérée du droit pénal à des fins politiques.
Quand bien même les faits seraient établis, les conditions d’arrestation et de détention rapportées sont contraires aux normes internationales et aux principes fondamentaux du procès équitable. Ces violations ne peuvent être justifiées par aucune nécessité procédurale. Un État de droit se juge à la manière dont il traite les personnes poursuivies, pas seulement à la manière dont il traite les innocents.
Quelle que soit l’issue de cette procédure, l’apparence d’une instrumentalisation de la justice pour réduire au silence un média critique porte atteinte à la crédibilité des engagements pris par les autorités en matière de libertés publiques. Cette apparence, même si elle était injustifiée, suffit à ternir l’image internationale du Gabon et à fragiliser la confiance des partenaires internationaux.
La transition gabonaise face à son test de crédibilité
L’affaire Harold Leckat, au-delà de son issue judiciaire, constitue un test pour la crédibilité de la transition gabonaise. Elle révèle, indépendamment de toute considération sur le fond, des dysfonctionnements procéduraux qui ne peuvent laisser indifférent quiconque est attaché aux principes de l’État de droit. Ces dysfonctionnements ne sont pas des détails techniques réservés aux juristes. Ils touchent au cœur du contrat démocratique entre le pouvoir et les citoyens.
J’appelle solennellement le Président de la République, en sa qualité de garant de la Constitution, à veiller au respect des procédures judiciaires et à s’assurer que la justice gabonaise ne devienne pas un instrument de règlement de comptes politiques.
J’interpelle la communauté internationale et l’Union européenne à observer avec attention l’évolution de ce dossier et à rappeler au Gabon ses engagements en matière de libertés publiques.
J’appelle les organisations de défense des droits humains et de la liberté de la presse, notamment Reporters Sans Frontières qui vient de saluer les progrès du pays, à exercer leur vigilance et à ne pas laisser cette affaire se dérouler dans l’indifférence internationale.
J’appelle enfin la société civile gabonaise, l’Organisation Patronale des Médias qui a courageusement condamné cette arrestation, et tous les citoyens épris de liberté, à exiger le respect des principes fondamentaux du droit.
Car si l’on accepte aujourd’hui qu’un homme soit jugé au mépris des règles, sous prétexte qu’il serait coupable ou déplaisant au pouvoir, c’est la garantie de tous qui s’effondre. Les droits fondamentaux ne protègent pas seulement les innocents, ils protègent tous les citoyens contre l’arbitraire du pouvoir. Le jour où l’on admet qu’une procédure irrégulière peut être tolérée parce que la personne visée déplaît, on ouvre la porte à toutes les dérives autoritaires.
Le peuple gabonais a été promis à une restauration des institutions et au respect de l’État de droit. Deux ans après le changement de régime, cette affaire révèle soit une incompétence juridique inquiétante dans le traitement des dossiers judiciaires, soit une instrumentalisation délibérée de la justice à des fins politiques. Dans les deux cas, c’est la crédibilité même de la transition qui est en jeu.
Le moment est venu de choisir entre la soumission et la dignité, entre la complicité passive et l’engagement démocratique. Pour ma part, j’ai choisi. Et je continuerai à dénoncer, avec la force du droit et la conviction du démocrate, tous les abus qui trahissent les promesses faites au peuple gabonais. L’histoire retiendra que certains ont eu le courage de dire non quand il fallait le dire, au moment où il fallait le dire. Elle retiendra aussi ceux qui ont préféré le silence complice.
Ali Akbar ONANGA Y’OBEGUE
Docteur en Droit
Enseignant à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques
Université Omar Bongo de Libreville
Secrétaire Général du Parti Démocratique Gabonais
Ancien Ministre




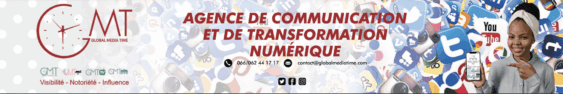




GMT TV
[youtube-feed feed=2]