Gabon : brutalité policière, deux tiers des citoyens dénoncent un usage excessif de la force

Selon Afrobarometer, 64% des Gabonais estiment que la police use trop souvent de la force contre les manifestants, et 57% affirment qu’elle agit de même lors des interpellations de présumés criminels. Ces chiffres accablants placent la gestion policière au cœur du débat sur l’État de droit et interrogent la responsabilité hiérarchique au sommet de l’institution.
Une police perçue comme répressive plutôt que protectrice. Dans un pays où les manifestations sont régulièrement encadrées par un important dispositif sécuritaire, les citoyens pointent du doigt la brutalité des forces de l’ordre. L’étude Afrobarometer publiée le 28 août 2025 révèle que près de deux Gabonais sur trois dénoncent des violences policières disproportionnées. Coups, intimidations et arrestations musclées alimentent un climat de peur, surtout lors des rassemblements publics.
« Au lieu de protéger les manifestants pacifiques, ils les dispersent comme s’ils étaient des ennemis », déplore un militant syndicaliste joint par Gabon Media Time. Cette perception mine profondément la légitimité de la police, censée être garante de la sécurité de tous.
Des standards internationaux ignorés
Les Nations unies, à travers leurs Principes de base sur l’usage de la force et des armes à feu (1990), stipulent que la force ne doit être employée que de manière proportionnée, progressive et en dernier recours. Au Gabon, la réalité décrite par les citoyens en est loin : 68% affirment que la police arrête souvent des conducteurs sans raison valable, un abus qui renforce l’image d’une institution agissant hors des standards internationaux. Cette dérive soulève une question cruciale : qui contrôle la police ? L’absence de mécanismes de reddition de comptes efficaces laisse penser que l’impunité reste la règle.
Si les bavures sont commises par des agents sur le terrain, la responsabilité s’étend à la hiérarchie. Le ministre de l’Intérieur Hermann Immongault a promis en mai 2025 de renforcer les capacités opérationnelles pour « lutter contre les violations des droits humains ». Mais tant que les sanctions resteront rares et que les victimes n’auront pas accès à une justice impartiale, la réforme restera une promesse vide. La responsabilité hiérarchique doit être engagée. Il en va de la crédibilité de l’État et de la protection des citoyens.
Restaurer la confiance, une urgence nationale. Le constat est clair : seule une police professionnelle, respectueuse des droits humains et contrôlée par des mécanismes indépendants pourra regagner la confiance des citoyens. Sans cela, chaque manifestation ou interpellation restera perçue comme une menace plutôt qu’une garantie de sécurité.




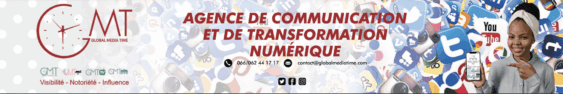





GMT TV
[youtube-feed feed=2]