Dix points cardinaux du tourisme au Gabon

Le tourisme vit au Gabon un renouveau qui en fait désormais un acteur majeur de l’économie du pays. L’Etat post CTRI, place ce secteur d’activité dans un rôle de pivot qui lui donne au fur et à mesure une importance inédite. Depuis 2023, après un état des lieux minutieux un vrai travail de fond a été fait : des sites touristiques nt été créés et des équipes ont été mises à contribution. La Caravane du tourisme 2025 a été imaginée puis lancée à la rencontre des populations. Ce fut une expérience authentique, nouvelle et dynamique. Elle a sillonné le pays du 15 juillet au 15 septembre 2025, suscitant un engouement dans la population. Ce renouveau nécessite un suivi et implique davantage l’Etat et les populations pour s’inscrire dans la durée et demeurer aussi vivace que prospère.
DIX POINTS CARDINAUX DU TOURISME AU GABON
L’Union du mercredi 10 septembre 2025 annonçait la fin de la Caravane touristique 2025 lancée le 15 juillet dernier par le circuit de l’Estuaire. Cette épopée animée, démonstrative et colorée a eu du succès, traversant villages, départements et provinces du Gabon profond. L’Etat gabonais, à travers le Ministre et ses équipes, a fait la promotion d’un tourisme qui doit être accessible et ouvert à tous. Nous venons ici en dix points tirer quelques enseignements généraux sur un secteur économique en pleine mutation. Cette publication propose d’explorer et d’approfondir quelques pistes. Elle s’inscrit dans la relation qui existe entre la géographie et le tourisme, comme l’écrivait Olivier Lazarotti en 2010 en ces termes : « parler de tourisme, n’est-ce pas aussi faire de la géographie, et réciproquement ? ».
- De quelques généralités et définitions
Le tourisme est un objet dont la définition ne cesse de poser des problèmes (Lazarotti, 2010). Dans tous les cas le tourisme est une « composante du développement au même titre que l’agriculture ou l’industrie » comme l’écrivait en 1988, Jean-François Zorn. Il s’agit d’un phénomène récent généralement étudié à travers sa comptabilité, né dans les pays industrialisés. Il s’est généralisé après 1936 avec l’adoption des conventions sur les congés payés et son impact à l’échelle planétaire ne date que d’une trentaine d’années. C’est en effet dans les années 2000 que le secteur a commencé à s’imposer dans l’économie mondiale jusqu’à atteindre plus de 400 milliards de dollars, soit 10 % du PIB mondial. Le secteur est désormais sorti du cadre des pays riches. Il s’affirme comme un outil de développement majeur des pays du Sud, et la « destination Gabon », version tourisme se met en place. Il va falloir éviter quelques écueils, des effets cachés tels que les risques et les atteintes à l’environnement et empêcher une mauvaise gestion de l’impact sur les sociétés locales. Le Gabon, pays côtier, doit résister à la tyrannie et l’attrait particulier des installations du littoral. Qu’à cela ne tienne, le tourisme est un réel défi pour le Gabon car : «Le tourisme n’est pas pour les pays en voie de développement une ressource naturelle aisée à exploiter » (François Ascher, Rapport de l’Unesco, 1980). Il ne fait évidemment pas de doute que le tourisme est un véritable outil de développement.
Ceci posé, rappelons que par tourisme l’on peut entendre : (1) agrotourisme (vente directe à la ferme ou séjour plus ou moins bref dans une exploitation agricole, ou encore des échanges avec des professionnels de l’agriculture) ; (2) écotourisme (centré sur la découverte de la nature, incluant le respect de l’environnement et de la culture locale) ; (3) pescatourisme (à bord de bateaux de pêche) ; (4) tourisme culturel (découverte du patrimoine culturel et du mode de vie d’une région et ses habitants) ; (5) tourisme balnéaire (en bord de mer : la forme la plus répandue dans le monde) ; (6) tourisme littéraire (forme de tourisme culturel d’un lieu particulier (maison, tombe, itinéraire, musée, lié à un auteur, un personnage même fictif, un acteur par exemple) ; (7) tourisme musical (en vue de participer à un festival, découverte d’un patrimoine musical) ; (8) ciné-tourisme ou cinématographique (de lieux devenus populaires ou apparus dans un filme ou une série) ; (9) tourisme d’affaires ou tout simplement voyage d’affaires (congrès, expositions, voyages) ; (10) tourisme médical (en vue de bénéficier d’un acte médical non disponible ou difficile d’accès dans son propre pays). On a aussi (11) le tourisme urbain (dans un espace urbain, loin de tout ce qui caractérise et représente une économie ou un milieu agricole) ; (12) le tourisme industriel (visite des symboles de l’activité industrielle ou artisanale), etc.
- Une nouvelle approche à explorer : les sites religieux
Avant l’arrivée du CTRI le tourisme était dans l’expectative et les tergiversations, se limitant à des projets imprécis et ambigus. Le CTRI impulse désormais une nouvelle vision et veut en faire un secteur stratégique de l’économie. De nouveaux projets ont été étudiés, évoqués et préparés. Certains sont même déjà concrétisés ou en cours d’exécution.
Rappelons qu’en 2023 un audit national avait permis de dresser l’état des lieux et d’évaluer le coût des ambitions du tourisme. Par la suite des circuits touristiques ont été mis en place et la Caravane Touristique 2025 a été expérimentée. C’est dire si le tourisme commence à prendre plus de poids et de place dans la vie économique et sociale du pays. Il s’inscrit dorénavant dans le panorama des nouvelles ambitions de l’Etat gabonais post Transition. Dans son édition numéro 14755 des samedi 15 et dimanche 16 février 2025, L’Union, évoquait en sa page 5, sous le titre « Vers la création des offices de tourisme » quelques unes des pistes d’action. Nous pensons que c’est là une série d’innovations intéressantes sur lesquelles les géographes et d’autres scientifiques reviendront certainement. Quelques mois plus tard le même journal, dans son édition numéro 14854 du Lundi 23 juin 25, en sa page 3, relevait que le Ministre du Tourisme durable et de l’Artisanat insistait sur l’urgence de la situation de l’hôtellerie qu’il va falloir « Relancer (l’hôtellerie) pour reconstruire le tourisme gabonais ». Un des faits marquants de cette « rencontre du 18 juin 2025 » était le lancement d’un partenariat public-privé. L’Etat gabonais compte s’affirmer et se limiter à son rôle « stratégique dans la gouvernance », note-t-on. Pour y arriver, entre autres, la gamme de produits doit être rentable, ne pas se limiter au strict minimum pour conforter le rôle et la position de l’offre de tourisme. La mission et la vocation du tourisme doivent vigoureusement changer d’orientation et de vision ; ce que le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) Vision 2025 et orientations stratégiques 2011-2016 n’évoquait nullement !
Parmi les nouvelles visions dans le monde il y a « la voie (ou même la voix) de l’Eglise » qui promeut non seulement une présence et un rôle déployé et épanoui des populations locales, mais aussi une meilleure visibilité des sites religieux. À ce propos en 1974 à Penang en Malaisie les églises du Tiers-Monde avaient posé une nouvelle question du tourisme selon laquelle les effets du tourisme ne pouvaient pas être isolés d’un contexte global. Les projets doivent incorporer un idéal de justice, de participation et d’autosuffisance. Un des objectifs doit être de permettre aux populations locales de participer aux décisions de recevoir une part équitable des bénéfices. En somme, il s’agit de promouvoir et utiliser les dispositifs d’accueil dont les propriétaires seraient des « gens du terroir », les « gens du village » en quelque sorte donc. Cette pratique pourrait s’appliquer avec succès dans le contexte gabonais : style reflétant les particularités locales et limitation des capacités. Certains spécialistes du tourisme affirment que ce serait une alternative concrète aux dispositifs hôteliers étrangers qui sont généralement de style importé, et surtout de grande capacité. Là aussi, la Caravane Touristique s’y est engagée. Dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement du pays, l’activité touristique se réorganise. Et avec les nouvelles mesures du CTRI, expérimentées en cette saison sèche 2025, le tourisme pourrait, dans son élan de « transformation significative profonde, durable et visionnaire », inclure cette donnée.
- Valoriser tous les sites et optimiser le potentiel de chacun
C’est comme si un nouveau dessein était confié au tourisme qui peut se résumer en une triple mission : restructuration, accueil et meilleure information. Et il lui revient de soutenir le développement à l’échelle du terroir par exemple. Un des grands défis du moment est de pouvoir s’adapter à ces nouveaux enjeux. Nous pensons qu’il est aussi impérieux, dans cet élan, d’assurer et promouvoir une meilleure visibilité des sites et des édifices religieux du pays. Cette publication est aussi un plaidoyer pour la valorisation des sites religieux dans un pays fortement christianisé.
En effet le Gabon est une nation où la foi chrétienne s’ancre de plus en plus dans ce que nous qualifierons ici de « traditions modernes ». Disons-le d’emblée, il ne s’agit nullement ici d’un appel à un « dualisme du tourisme » qui pût consister en un circuit des « sites naturels et des lieux des traditions et légendes » d’un côté, et des « sites religieux (d’hier et éventuellement d’aujourd’hui) » de l’autre. Car un « dualisme » signifierait une mauvaise intégration d’une des deux catégories de sites. Certains départements du littoral et/ou de l’intérieur, ou encore des terroirs et même des villages, sont connus du fait de la présence d’une église, généralement héritée de la période coloniale, avec, chacune, sa touche locale unique et authentique. L’on pensera ici aisément à certains sites religieux tels que :
- la mission Sainte Anne dans la lagune Fernan Vaz dans la province de l’Ogooué-Maritime ;
- la mission catholique de Ngomo sur l’Ogooué, ou encore la mission catholique Saint François Xavier de Lambaréné dans le Moyen-Ogooué ;
- vers la ville de Fougamou l’on a la mission de Sindara ;
- puis au nord du pays, on retiendra l’église Sainte Thérèse d’Angone.
De fait, l’Eglise est devenue un élément de la culture au Gabon. L’attrait de ces lieux a déjà suscité à travers la Caravane de 2025 un intérêt réel. Sur le plan historique l’on sait que l’Eglise y a eu de grandes figures, notamment des missionnaires parmi lesquels des voyageurs tels que : Monseigneur Jean-Rémi Bessieux (1803-1876), un des pionniers de l’œuvre missionnaire au Gabon, Monseigneur Raponda Walker (1871-1968), Monseigneur Marcel Lefebvre et son frère René, Robert Hamill Nassau (1835-1921), John Leighton Wilson (1809-1886), Elie Allégret (1865-1940), pasteur Fernand Grébert (1886-1956), etc.
Nous pensons qu’il est possible d’enrichir le circuit touristique actuel en créant un circuit spécifique comprenant au moins une partie des sites religieux cités plus haut. Ceci pourrait constituer une sorte de « chemin de Saint Jacques de Compostelle à la gabonaise ». Qu’on ne se méprenne pas : il ne s’agit pas ici de tourisme religieux, encore appelé tourisme de la foi, lequel conduirait à une sorte de pèlerinage ou de tout autre rassemblement à caractère religieux, mais de visites guidées avec ou sans conférencier.
Pour assurer une réussite tangible et une connexion harmonieuse entre tous les sites, les liaisons devront être fluides. Sinon il en résulterait des échanges incomplets et incontestablement le projet ne serait pas du tout rentable ni pour le pays ni pour l’économie. Ce sont là des évidences sur lesquelles il n’est pas besoin d’insister ici. Au final, tout ceci devrait commodément se refléter dans l’architecture du Ministère du Tourisme, certes, mais aussi dans les projets et les réalisations sur le terrain.
- Pourquoi un plaidoyer pour une visibilité des sites touristiques religieux ?
Tout d’abord parce qu’il s’agit d’une pratique commerciale rentable pour le secteur touristique. Le cas le plus récent est la réouverture le 08 décembre 2024 (incendie le 15 avril 2019) de la cathédrale Notre Dame de Paris qui a attiré environ 8 millions de visiteurs en neuf mois seulement, stimulant énergiquement le tourisme non seulement à Paris, mais aussi dans tout le pays. L’impact touristique fut indéniable. Ensuite, parce que le Gabon est un pays où les édifices religieux hérités de la période coloniale sont encore en bon état général comme les photos le montrent plus haut. Ils représentent de ce fait, une richesse touristique indéniable.
Enfin, parce que la religion chrétienne a toute sa place dans l’espace culturel gabonais. En effet, « Dieu, foi et miracle » sont évoqués sans équivoque ici et là, depuis les plus hautes autorités jusqu’aux « mapanes » ou « matitis ». Les références à la religion chrétienne sont visibles, multiples et variées depuis les villes jusque dans les villages. Dans le pays chaque capitale provinciale a une ou plusieurs églises ! La religion chrétienne est partout ou presque. Rares sont les départements administratifs du pays qui n’ont pas leurs sites religieux « d’avant l’indépendance ». en conséquence, une opération du genre « nos cathédrales, potentiel (ou richesse) touristique » soutenu par une campagne publicitaire et des prix promotionnels aurait un effet positif, vu que les médias, à travers journaux, chaines de télévision et radios nationales, ne sont pas en reste non plus dans la dynamique de « réinvention du Gabon » comme le titrait Jeune Afrique, n°3152, septembre 2025, Grand format Gabon, « dossier les 10 parcs économiques pour 2035 ».
Une autre raison est l’engouement des fêtes chrétiennes : quelle euphorie ! Que de cérémonies religieuses à Noël et à Pâques ! Ce sont d’autres faits qui attestent encore que le Gabon est bien un pays dont la culture intègre bien la chrétienté. Il est en conséquence malaisé de constater que les sites religieux sont aujourd’hui en retrait dans les promotions, les projets et le circuit touristique actuel. Une raison supplémentaire est que les sites religieux participent à la connaissance des faits historiques et sociaux du pays. Ils sont des lieux emblématiques qui devraient être valorisés et accessibles à tous à ce titre. Mais bien incontestablement un dialogue s’avère nécessaire entre les responsables du Ministère du Tourisme et les autorités ecclésiastiques pour asseoir une carte à cet effet.
Un autre avantage strictement économique celui-là, à défaut d’être structurel, est de ne pas dépendre d’un seul type de marché. La variété des sites permet de diversifier la clientèle et souscrit même parfois une segmentation entre les différentes classes d’âge. Diversifier sa clientèle permet aussi d’étaler par exemple les saisons : autour des fermetures des classes, des vacances scolaires, des fêtes de fin d’année et d’atteindre ainsi une rentabilité optimale. Le client peut de ce fait passer d’une gamme de produits à une autre. Et ici entre aussi en jeu le rôle des échanges pour adapter et/ou faire évoluer l’offre touristique tout en évitant évidemment au client un surcoût !
- Assurer un effet d’entrainement
Le succès du tourisme au Gabon est fonction de l’effet d’entrainement des sites ouverts, accessibles et disponibles. Il est possible et légitime d’en attendre un effet d’entrainement appuyé sur l’intérêt des nationaux pour la (re)découverte de leur pays. Ce doit être offrir de nouvelles occasions pour visiter et repérer les différentes spécificités des territoires ruraux, « les fins fonds du pays », comme on aime entre nous. Il est essentiel d’englober et de mettre en valeur une variété de sites. L’on peut constater que le potentiel des sites religieux n’est pas encore globalement exploité ; ce qui réduit son impact et en limite de fait la rentabilité économique.
L’on pourrait présupposer qu’il persisterait un doute ou une réserve sur leur capacité à infuser la prospérité autour d’eux ; ce qui reste à démontrer ! Et il n’est pas nécessaire de fournir ici un catalogue ou de revenir sur l’histoire des sites religieux du pays. Par ailleurs, celle de chacun d’eux est à elle seule suffisante pour valider, s’il était besoin, notre plaidoirie. Dans tous les cas ils ne devraient pas subir une disproportion dans leur traitement et leur mise en valeur. Et même si un éventuel réseau des sites religieux ne couvrait pas l’ensemble du territoire national, il s’agit de façon générale, de sites anciens qui offrent d’indéniables avantages. Et dans ce lot d’avantages l’on pourrait encore ajouter leur contribution dans la lutte contre l’exode rural puisqu’ils fixeraient une partie des jeunes y trouvant là, un emploi et une source de revenus sûre et régulière. Il est certain que l’activité touristique du Gabon est à mesure d’offrir des emplois saisonniers.
- L’emploi évidemment
Le tourisme est un secteur moteur de l’économie dans de nombreux pays. Il offre une grande variété d’emplois : accueil (sur site, parc), (hôtellerie, restauration, animation (sportive et loisirs), événementiel, transport, hébergement, excursion, accompagnement (guide-conférencier), maintenance, propreté, chargé de projet, etc. Dans l’accueil par exemple, il n’est pas nécessaire d’avoir une qualification particulière ou poussée. La nouvelle vision doit élargir l’offre des formations, exiger des compétences nouvelles et des métiers nouveaux, les uns permanents, les autres saisonniers. En plus de la promotion du monde rural, la mise en valeur des sites religieux offrirait aussi des occasions de dynamiser l’esprit d’entreprise des autochtones tant décrié ces dernières années.
Tout compte fait, le rayonnement du tourisme y gagnerait dans tous les cas. Car, mêmes embryonnaires ou rudimentaires, des sites religieux valorisés dans le circuit touristique national déjà en place et opérationnel, contribueraient autant au rayonnement culturel recherché. Rappelons qu’actuellement dans le tourisme la tendance est à la sobriété car les modèles de luxe sont en chute un peu partout dans le monde. En définitive, que l’une ou l’autre catégorie soit plus prospère, la diversification serait bénéfique au secteur tout entier et en raffermirait la réussite.
- Fidéliser la clientèle : un défi de taille
Le pays est sous-peuplé (2,6 millions (2024)) et le revenu moyen est assez (très) faible, vendre des produits touristiques et fidéliser la clientèle sont de grands défis qui ne sont pas insurmontables. La base est de proposer une diversité de produits et de répondre aux exigences de la clientèle en tenant compte de deux paramètres essentiels : son (faible) revenu et son (peu de) temps disponible. Sur place le client veut profiter au maximum des installations du site et des activités. Mais il ne dispose généralement que de peu de temps, et ne veut pas en perdre dans des offres et services approximatifs.
Tenir compte de la clientèle c’est être en mesure de transformer, s’il le faut, certains sites en profondeur et les adapter. C’est aussi prendre en considération l’intégration d’une jeunesse (rurale aussi) de plus en plus nombreuse et ne pas oublier les exigences des seniors car en matière touristique, ce n’est pas le désir de consommer qui est en cause mais plutôt la façon de consommer. Pour rester dans cette rubrique, ajoutons que le client recherche des prix bas et des produits auxquels il peut s’identifier. Comme le client est changeant, on ne peut le gagner qu’en le fidélisant. Il ne se contente pas de promesses ni de surpromesses et c’est lui qui fera la réputation du site qu’il visitera. Pour y arriver le chemin peut paraître ardu, parsemé d’embûches car il dispose de peu de temps et pas assez de moyens financiers. Comment le convaincre, le satisfaire et éventuellement le suivre, et surtout le ramener ?
Il est important pour la survie et la rentabilité d’un site que le client en parle en bien autour de lui, même s’il ne revenait pas un jour. Il ne serait pas superflu mais bien plus avantageux de mettre à la disposition de la clientèle un questionnaire de satisfaction auquel pourrait s’ajouter un « Cahier de doléances ». On voit que la communication a une centrale et les informations devront être fournies et disponibles à tout le public.
- Veiller sur la qualité des sites
Les destinations et les sites doivent être accessibles et avoir des prix très abordables pour fidéliser la clientèle. Et sur ce point la qualité des services est un des meilleurs atouts. Sous l’impulsion d’une équipe bien formée et motivée, les acteurs devenus peu à peu indispensables, font partie d’un réseau de professionnels locaux capables de promouvoir différentes destinations et sites pour répondre au mieux aux objectifs à atteindre.
Le contrôle régulier de la conformité et des performances des installations est fondamental. Il pourrait être confié à des agents de l’Etat, du Ministère du Tourisme ou des représentants locaux qui établiraient par exemple un classement valable trois, cinq ou sept ans. Celui-ci pourrait être signalé par un panonceau, attribuant ici ou là un nombre d’étoiles en fonction de différents critères tels que : le professionnalisme et la (les) qualification(s) de l’équipe, les horaires d’ouverture des sites, des services et des animations, la motivation, l’imagination, la créativité, etc. Chaque site pourrait avoir évidemment son noyau propre, son budget, sa stratégie unique. Généralement les équipes ont en leur sein un développeur chargé de mettre en place la stratégie de développement en concertation avec les autorités du Ministère. Il est en quelque sorte l’élément catalyseur. Et ces professionnels travailleraient autour d’un axe de promotion précis et adapté à chaque site. On y trouverait aussi par exemple un homme ou une femme de communication, diplomate et très disponible dont une des fonctions essentielles serait d’animer et fédérer les volontés et les actions sur place. On sait qu’une bonne équipe de tourisme se caractérise par la polyvalence. Ceux-ci connaissent la géographie, la culture, l’histoire des lieux. Ils sont ainsi aptes à accueillir, orienter et informer. Le tourisme est aussi une affaire commerciale à rentabiliser qui nécessite des études précises, des projections, une vision distincte et réaliste.
Au fil du temps il va falloir archiver, documenter, centraliser, adapter, avec des guides conférenciers. Là, les monuments religieux du Gabon offrent des avantages historiques.
- La nécessité de former
Il va falloir intensifier et élargir la gamme des produits touristiques du pays, étoffer la force de vente, développer et innover les promotions, etc. Au contact de cette variété il est fort probable que les comportements de consommation touristique changent rapidement, favorisant l’apparition de nouveaux métiers. Un plan de formation ciblée s’impose dès lors, déjà donc indispensable. Au fur et à mesure le niveau du personnel s’élèvera, que ce soient des directeurs, des chargés de promotion ou d’études, de conception ou de commercialisation. Les concepteurs des produits touristiques pourront être au centre du nouveau dispositif même si, notamment au début, la majorité des emplois pourraient être occasionnels ou saisonniers (missions des prestataires). Car généralement au niveau institutionnel le nombre d’emplois est faible. Pour mieux vendre, dans certains cas la fonction d’accueil pourrait être associée à celle de conseil.
Dans le cadre d’un site et d’un monument religieux, à défaut de personnel qualifié l’on pourrait compter sur les bénévoles dont la place est incontournable dans bien d’autres régions du monde (Lourdes, cathédrale Notre Dame de Paris en France, Vatican, etc.). Ces bénévoles pourraient même s’organiser en association ou toute autre petite structure dans le milieu rural. Un des grands avantages d’une structure associative est de pouvoir mobiliser rapidement les forces vives, c’est-à-dire, le personnel et les compétences qui, par exemple dans un premier temps ne pourraient pas créer des emplois salariés. Ceci dit, les bénévoles, disponibles par définition, pourraient toutefois bénéficier d’un minimum de formation initiale et continue. La gratuité, tout comme l’investissement social, a parfois des règles et des conditions dans la mesure où elle implique des responsabilités effectives.
La formation à mettre en place devrait être bénéfique au plus grand nombre et garantir la participation aux concertations, même officielles. Ce serait une forme d’encouragement et d’incitation au bénévolat. Au budget alloué à chaque site s’ajouteraient les recettes de la commercialisation des prestations, de produits touristiques propres à chaque site, de la vente de voyages et de séjours, de fêtes, de salons, de manifestations artistiques, d’organisations de « semaines ou quinzaines » culturelles ou gastronomiques, par exemple autour du 17 ou 30 août (avant et/ou après) ou encore à la fin de l’année scolaire, etc. Il va sans dire qu’il faudra tenir compte de l’impact de la saisonnalité qui pourrait avoir des incidences négatives, des disparités de fonctionnement. Selon les saisons il y pourrait y avoir certainement des pointes entre juin et août/septembre. Peut-être alors faudrait-t-il alors envisager dans certains cas, ou dans certaines périodes (vacances scolaires ou périodes de fêtes), des ouvertures ou du moins des réservations d’hébergements vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Partout dans le pays, un des objectifs majeurs sera de gagner, fidéliser, convaincre, satisfaire, motiver des clients qui ne formuleront pas toujours leurs attentes. C’est ici que l’agent d’accueil a un rôle crucial. Car il lui reviendra de leur fournir des informations pointues et précises sur le produit (tarifs, disponibilités, descriptif, etc.). Valoriser en peu de temps le potentiel touristique, la région, est déterminant pour fidéliser le client. On peut en déduire que l’information, au cœur de ce (projet/but) devra être de qualité, fiable et sécurisée, adaptée à la demande et au moment, et juste : sans surévaluer ni sous-évaluer les données. Compétent et sûr de sa source devra être l’agent alors. Le client doit repartir dans tous les cas satisfait, l’animation locale ayant de son côté joué parfaitement son rôle. La vie touristique autour des sites devra être incitative à… revenir et circuler dans un pays où le bouche à oreille peut encore forcer la décision. Le client qui viendrait de loin aura alors affaire à une population sensibilisée, composée d’autochtones fiers de leur patrimoine, de leur histoire, de leur culture, de leur contrée et de leur site touristique. Ils en tireraient, eux aussi d’ailleurs, dans la mesure du possible, un (gain) économique.
- L’art de bien vendre l’offre touristique
Voici venue l’heure d’éditer des brochures commerciales, des guides d’accueil, qui identifient le potentiel touristique de chaque site : les différences, les richesses et singularités locales, les traditions (y compris orales) et légendes, la nature, le paysage, la gastronomie, le mode de vie, l’histoire, la notoriété, les loisirs du site, bref, tout ce qui est susceptible de déclencher l’intérêt et le choix du client pour cette destination, pour un séjour… à renouveler et à conseiller.
Les installations du littoral ne doivent pas devenir les principaux pôles touristiques du pays au moment où une riviera est en projet. L’intérieur doit détenir des stations intégrées, accessibles et porteuses du tourisme rural (impliquant un regain d’intérêt pour l’art et l’artisanat) et de découverte de régions et terroirs uniques. Ce sont de nouveaux produits sources de richesses nouvelles permettant la hausse du niveau de vie. Ceci implique l’adaptation des économies locales nécessairement.
Avant de finir il importe de présenter les principales caractéristiques des sites touristiques.
- Caractéristiques des principaux sites touristiques
Le Gabon a donc décidé de mettre en valeur les facteurs géographiques, culturels, et dans une moindre mesure, religieux, de ses sites touristiques sous plusieurs facettes, parmi lesquels les aspects suivants :
- les hauteurs : Monts de Cristal (Estuaire), Waka (Ngounié), Monts d’Efau (Woleu-Ntem, Medouneu), de Birougou (Ngounié/Ogooué-Lolo)
- la variété des paysages : parcs nationaux : la mangrove (Akanda, Nyoniè et Pongara (Estuaire), la savane arborée et les galeries forestières (parc national de la Lopé (Ogooué-Ivindo) inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO))
- la forêt équatoriale et ses richesses : Plateaux Batékés (Haut-Ogooué), Moukalaba-Doudou (Nyanga), Ivindo et Mwagna (Ogooué-Ivindo) et Minkébé (Woleu-Ntem)), Arboretum Raponda Walker (Estuaire)
- la côte sableuse et les diverses autres richesses : Loango (Ogooué-Maritime), Baie des tortues et et Mayumba (Nyanga))
- les lagunes (Nkomi, Iguéla (Ogooué-Maritime) et Ndogo (Nyanga)).
Au premier abord certains sites paraissent largement mettre en avant l’étoffe locale et le cachet du terroir, certes bénéfiques, mais qui semblent encore orienter l’action des autorités.
En guise de conclusion, nous mentionnerons qu’un des accomplissements les plus aboutis est la fin de la confusion et de l’inertie. L’action a enfin pris le pas sur la torpeur, l’immobilisme et l’inconséquence. Le tourisme doit avoir un impact modernisant. Il semble cette fois-ci, émancipé de l’héritage colonial. Il est désormais pensé et projeté sur le long terme. Il en résulte des attentes justifiées d’un retour sur investissement, notamment des opérateurs de la Caravane touristique 2025 et tout semble être mis en place à cette fin et les innovations se succèdent. Que l’action ne soit plus enfin perturbée par des initiatives parasitaires. Qu’elle contribue plutôt à maintenir un flux touristique conséquent même hors saison. Une des solutions à privilégier pourrait être de valoriser et favoriser les courts séjours et en priorité, ceux de proximité. Naturellement un des objectifs fondamentaux reste d’optimiser le remplissage de chaque site. Et un des objectifs est d’attirer un maximum de touristes intéressés par la culture, la nature et l’authenticité des différents terroirs. Mettre en valeur au Gabon les sites serait un atout qui enrichirait incontestablement le patrimoine touristique national.
Henri-Pierre Awonguino-Ndèlia, Géographe Tropicaliste.




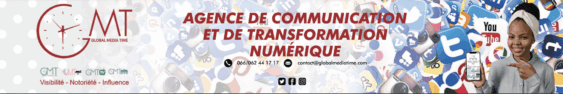





GMT TV
[youtube-feed feed=2]