Ali Akbar Onanga Y’Obeghe : « qui conseille réellement le président Oligui Nguema »

Il est des critiques nécessaires qui ne relèvent ni de l’opposition systématique ni de la posture politicienne, mais de la responsabilité civique. Lorsqu’un pays s’enlise dans des décisions incohérentes, juridiquement fragiles et socialement explosives, la question n’est plus seulement celle du pouvoir exercé, mais celle de la qualité du conseil qui précède l’acte.
Le Gabon est aujourd’hui confronté à une évidence que beaucoup refusent encore de regarder en face : le Président de la République est mal conseillé. Non pas ponctuellement, non pas marginalement, mais structurellement, durablement et dangereusement.
Et cette situation ne relève ni du hasard ni de la fatalité. Elle est le produit d’un entourage qui a renoncé à sa mission première : celle de dire la vérité au Chef, même lorsque cette vérité dérange, même lorsqu’elle irrite, même lorsqu’elle expose à une colère passagère. Pire encore, cet entourage semble avoir fait le choix délibéré d’une forme de sabotage silencieux, exposant le Président aux conséquences désastreuses de décisions mal préparées, mal articulées, et manifestement contraires à l’intérêt national.
I- Un Président militaire n’est pas fautif de ne pas tout savoir
Il convient de le dire avec clarté et honnêteté, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema est un militaire. Sa formation, sa culture professionnelle, son rapport à l’autorité et à la décision sont ceux d’un officier supérieur. Cela ne le disqualifie en rien pour diriger un État. Mais cela implique une chose essentielle, il a besoin de collaborateurs solides, compétents, courageux et loyaux dans le sens noble du terme.
Un Président n’a pas à être constitutionnaliste, administrativiste, fiscaliste, macroéconomiste, politologue etc. En revanche, ceux qui l’entourent doivent l’être, car c’est précisément pour cela qu’ils ont été choisis. Leur rôle n’est pas d’applaudir, ni de flatter, ni de protéger leurs privilèges. Leur rôle est d’éclairer, d’alerter, de prévenir et parfois de s’opposer intelligemment.
Or, force est de constater que cette mission fondamentale a été abandonnée. Les collaborateurs actuels du Président semblent avoir fait le choix de la facilité, du confort et de la complaisance. Au lieu de protéger le Chef de l’État contre l’erreur, ils l’y conduisent. Au lieu de le prémunir contre le discrédit, ils l’y exposent. Au lieu de servir l’intérêt supérieur de la nation, ils servent leurs propres intérêts, leurs propres carrières, leurs propres ambitions.
Une remarque revient souvent dans les cercles du pouvoir : « Le Président n’écoute pas toujours les avis contraires. » Cet aveu, souvent prononcé à mi-voix, est en réalité accablant, non pour le Chef de l’État, mais pour ceux qui s’en prévalent. Car il signifie : « Nous savons que certaines décisions sont discutables, mais nous avons préféré nous taire. »
Cette posture n’est pas seulement lâche. Elle est une trahison de la fonction publique. Un vrai conseiller ne renonce pas à son devoir sous prétexte que son chef est peu réceptif. Il parle avec justesse, assume l’impopularité, et accepte même de perdre de l’influence pour défendre l’intérêt supérieur.
Ce courage-là fait cruellement défaut aujourd’hui au sommet de l’État. Et cette carence produit des effets concrets : instabilité, méfiance, improvisation. Ce n’est plus de l’incompétence. C’est de la déloyauté.
II- Les exemples accablants d’un conseil présidentiel défaillant
Le constat établi ci-dessus trouve son fondement dans des faits précis, publics, vérifiables, qui, mis bout à bout, dessinent un même schéma : celui de décisions majeures prises sur la base de conseils erronés, incohérents ou politiquement suicidaires, exposant inutilement le Président de la République et affaiblissant durablement l’autorité de l’État.
Trois exemples, arbitrairement choisis parmi tant d’autres, permettent d’illustrer le propos et de démontrer le caractère systématique de cette défaillance du conseil présidentiel.
1) La farce des ministres-députés : quand le bricolage constitutionnel devient une méthode de gouvernement
Le 1er janvier 2026, treize ministres démissionnaires en novembre dernier pour cause d’élection au Parlement ont été rappelés au gouvernement. Un retour qui défie toute logique juridique et consacre le triomphe du bricolage institutionnel sur la cohérence républicaine.
L’épisode constitue l’une des démonstrations les plus éclatantes de la faillite du conseil constitutionnel entourant le Président. Le 14 novembre 2025, plusieurs ministres fraîchement élus députés étaient priés de quitter le gouvernement au nom de l’article 73 de la Constitution de 2024 qui pose l’incompatibilité entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire. Au nom de la « clarté institutionnelle », ces ministres devaient se démettre sans délai.
Quarante-huit jours plus tard, treize d’entre eux sont de retour au gouvernement. Même poste pour certains, portefeuilles réaménagés pour d’autres, mais tous réintégrés dans l’exécutif alors qu’ils demeurent députés. L’article 73 n’a pas changé. L’incompatibilité constitutionnelle demeure intacte. Seule l’interprétation a été inversée, au gré des besoins politiques du moment.
Dans ma tribune de novembre, j’avais critiqué la lecture rigide de l’article 73. J’avais souligné qu’en droit comparé, notamment en France dont notre Constitution s’inspire, un ministre élu député dispose d’un délai pour opter. Si la précipitation de novembre était critiquable, le retour de janvier est proprement inacceptable. Ce yo-yo ministériel révèle un amateurisme inquiétant au sommet de l’État.
Cet amateurisme trouve sa source dans le régime hybride institué par la Constitution de décembre 2024, pompeusement baptisé « présidentialiste ». Ce régime, que personne au sommet de l’État ne maîtrise vraiment, condamne le pays à naviguer à tâtons. Le Gabon a abandonné le régime semi-présidentiel connu et maîtrisé par nos ressources humaines pour un système que même ses concepteurs semblent incapables d’appliquer avec cohérence.
Car il y a pire : une contradiction structurelle. Un régime présidentiel authentique interdit la nomination de parlementaires au gouvernement. C’est le principe même de la séparation stricte des pouvoirs. Or, que constate-t-on ? Le Président nomme systématiquement des parlementaires au gouvernement. Mieux : après les avoir fait démissionner en novembre pour incompatibilité, il les rappelle en janvier alors qu’ils sont toujours députés !
On prétend instaurer un régime présidentiel, mais on garde les pratiques parlementaires. On invoque la séparation des pouvoirs, mais on maintient le cumul. On brandit la Constitution, mais on l’interprète à géométrie variable. Le droit n’est pas un jouet, et la Constitution n’est pas un Lego.
Cette mascarade doit cesser. Il faut réviser cette Constitution qui expose inutilement le Président et condamne le pays à l’improvisation permanente. Le retour au régime semi-présidentiel permettrait de redonner sa cohérence à cette pratique des ministres-députés, avec l’avantage non négligeable qu’il consacrerait le retour d’un Premier ministre Chef du gouvernement assumant son rôle de fusible politique, protégerait le Chef de l’État des erreurs sectorielles et lui permettrait de se concentrer sur les fonctions régaliennes.
2) La contradiction mortelle entre le discours du 31 décembre et la promotion du 1er janvier : l’art du sabotage par double langage
Un deuxième exemple, sans doute le plus destructeur pour la crédibilité présidentielle, demeure la séquence politique ouverte par le discours de vœux du 31 décembre 2025, puis refermée brutalement le 1er janvier 2026. En vingt-quatre heures, le Président a été conduit à se contredire frontalement. Cette contradiction n’est pas le fruit du hasard. Elle est le produit d’un conseil défaillant qui expose le Chef de l’État au ridicule institutionnel.
Dans son discours de vœux, le Président a franchi un seuil politique inédit. Il a reconnu explicitement que les derniers scrutins ont été entachés de dysfonctionnements sérieux. Il a évoqué des irrégularités, des manipulations, des failles dans l’organisation électorale. Autrement dit, il a lui-même dressé la liste des leviers classiques de fraude qui, dans n’importe quel système démocratique, suffisent à invalider une compétition électorale.
Or, cet aveu intervient après la clôture du cycle électoral, après la proclamation des résultats, après l’installation des élus, et surtout après que le pouvoir a pleinement bénéficié de ces résultats. Dans toute pratique républicaine cohérente, un tel diagnostic engage politiquement l’État et appelle des conséquences institutionnelles immédiates.
La première de ces conséquences est évidente : l’écartement du principal responsable de l’organisation de ces scrutins, en l’occurrence le ministre de l’Intérieur.
Or, c’est exactement l’inverse qui se produit. Le lendemain même de cet aveu présidentiel, le ministre de l’Intérieur est promu vice-président du gouvernement, une fonction qui exerce des prérogatives équivalentes à celles d’un Premier ministre.
Cette promotion annihile politiquement le discours du 31 décembre. Elle le vide de toute portée et transforme un aveu de vérité en simple posture rhétorique, sans traduction institutionnelle. Face à cette séquence, deux lectures seulement sont possibles, et aucune n’est favorable à la crédibilité du pouvoir.
Première lecture : Le Président est réellement convaincu que les élections ont été gravement fraudées. Dans ce cas, promouvoir le ministre de l’Intérieur est une aberration politique qui fait du Chef de l’État le complice conscient d’une manipulation électorale qu’il vient de dénoncer publiquement.
Deuxième lecture : Le Président est satisfait du travail accompli par le ministre de l’Intérieur. Dans ce cas, pourquoi ce discours d’aveu ? Il aurait dû être un satisfecit assumé, justifiant la promotion accordée.
Quelle que soit l’hypothèse retenue, la conclusion est accablante : le Président a été piégé par ses propres conseillers. Qui a validé un discours d’aveu sans en tirer les conséquences institutionnelles ? Qui a conseillé la promotion d’un ministre dont l’action venait d’être publiquement mise en cause par le Chef de l’État lui-même ?
Cette duplicité relève du sabotage politique. Elle expose le Président et installe une défiance profonde dans l’opinion publique. Plus grave encore, elle discrédite durablement la parole présidentielle. Comment croire désormais les engagements du Chef de l’État quand ceux-ci peuvent être contredits vingt-quatre heures plus tard par les décisions prises en son nom ?
3) Le budget 2026 : un pari irresponsable qui expose le Président au discrédit international
Le projet de loi de finances pour 2026 constitue une autre illustration révélatrice de la défaillance du conseil présidentiel. Ce budget repose sur une hypothèse centrale : un taux de croissance économique compris entre 7 et 8 %. Autrement dit, une quasi-multiplication par trois de la performance économique récente du Gabon en l’espace d’un an.
Lisons bien ce chiffre : 7 à 8 % de croissance. Pour un pays qui peine à dépasser 2 à 3 % depuis plusieurs années, c’est annoncer un miracle économique sans précédent. Pour donner un ordre d’idée, le Rwanda, considéré comme l’un des champions africains de la croissance, affiche une moyenne de 7 % sur une décennie entière, grâce à des réformes structurelles profondes et à un pilotage macroéconomique rigoureux. Le Gabon prétend atteindre ce niveau en un an, sans réforme d’ampleur comparable, sans choc positif identifiable, sans révolution productive visible.
Or, cette hypothèse ne résiste à aucune analyse sérieuse. Les institutions internationales de référence, FMI, Banque mondiale, Banque africaine de développement notamment, convergent vers une projection beaucoup plus prudente : une croissance comprise entre 2 et 3 % pour 2025-2026.
Pourquoi ces institutions contestent-elles la trajectoire gouvernementale ? D’abord, pour une raison élémentaire d’historique économique. Passer brutalement de 2-3 % à 8 % supposerait un choc positif majeur tel que l’explosion des exportations, la découverte et la mise en production immédiate de nouveaux gisements pétroliers ou miniers, ou encore une exécution exceptionnelle de l’investissement public. Or, aucun de ces facteurs n’est aujourd’hui solidement établi.
Ensuite, parce que le cadrage gouvernemental table sur une montée en charge rapide des investissements publics, une croissance spectaculaire du secteur non pétrolier (bois, mines, agriculture) et une amélioration continue des prix et volumes d’exportation. Ces projections supposent que les projets soient prêts, financés, contractualisés, exécutés sans délai, et sans blocage administratif. L’expérience gabonaise démontre précisément l’inverse : retards systématiques, lenteurs administratives, décalages chroniques entre annonces et réalisations.
Le cadrage irréaliste du gouvernement n’est donc pas seulement un problème technique. Il est politiquement et financièrement dangereux. Les agences de notation et les institutions financières internationales ont déjà exprimé leurs réserves. Un déficit trop élevé, adossé à des hypothèses de croissance fragiles, peut compromettre l’appui financier extérieur, renchérir le coût de la dette, dissuader l’investissement privé et, in fine, fragiliser la souveraineté économique du pays.
Plus grave encore, ce budget expose le Président au ridicule international. Lorsque les partenaires financiers du Gabon constateront, comme ils le feront inévitablement dans quelques mois, que la croissance réelle ne dépasse pas 2 à 3 %, comment le Chef de l’État pourra-t-il conserver sa crédibilité ? Comment pourra-t-il défendre la parole du Gabon dans les instances internationales après avoir validé des prévisions aussi manifestement fantaisistes ?
III- L’impasse du régime « présidentialiste » : pourquoi une révision constitutionnelle est devenue urgente
Les trois exemples qui précèdent ne sont pas des incidents isolés. Ils sont les symptômes d’un désordre institutionnel profond, où l’improvisation supplante la règle, où la prévisibilité disparaît, et où la République est conduite à contretemps. Ce bricolage constitutionnel fragilise durablement l’État de droit, expose le Président de la République au discrédit, et nourrit la défiance des citoyens à l’égard des institutions.
À la racine de ce désordre se trouve un choix institutionnel mal conseillé : l’adoption d’un régime dit « présidentialiste » que personne ne maîtrise réellement, ni dans sa logique, ni dans ses implications pratiques. Ce régime condamne le Président à assumer simultanément la fonction de Chef de l’État, celle de Chef du gouvernement, celle d’arbitre politique, et celle de gestionnaire quotidien de l’action publique. C’est une absurdité politique dans le contexte gabonais.
Et cette absurdité n’est pas le fait du Président. Ce sont ses conseillers qui l’ont conçue, validée, et imposée.
Je suis persuadé que les concepteurs de cette constitution n’ont pas expliqué au Président que, dans la tradition politique gabonaise, le Premier ministre en sa qualité de Chef du gouvernement jouait un rôle de régulation indispensable, de paravent institutionnel, de fusible politique. Qu’en supprimant cette fonction, le Président serait inutilement exposé à toutes les critiques, à toutes les colères sociales, à toutes les erreurs politiques ou administratives, qu’elles soient générales ou sectorielles. Ils l’ont placé en première ligne, sans protection, sans recul, sans possibilité de délégation efficace.
Le régime semi-présidentiel, que le Gabon a pratiqué pendant des décennies, présentait certes des imperfections. Mais il avait un mérite essentiel : il était connu, maîtrisé par nos ressources humaines politiques et administratives, rodé par la pratique. Le Premier ministre en sa qualité de Chef du gouvernement jouait un rôle de régulation indispensable, de paravent institutionnel, de fusible politique. Il permettait au Chef de l’État de se concentrer sur les fonctions régaliennes. Il protégeait le Président. Il garantissait une certaine fluidité institutionnelle. Il permettait des ajustements politiques sans remettre en cause l’autorité du Chef de l’État.
En supprimant cette fonction, le régime « présidentialiste » expose le Président à tous les tirs, pour toutes les décisions, dans tous les secteurs. Un échec ministériel ? C’est l’échec du Président. Une maladresse administrative ? C’est la responsabilité du Président. Une colère sociale ? Elle se dirige directement vers le Chef de l’État. Ce système est un piège institutionnel qui affaiblit structurellement le pouvoir présidentiel au lieu de le renforcer. Il est placé en première ligne, sans protection, sans recul, sans possibilité de délégation efficace.
Au demeurant, l’affaire des ministres-députés constitue, à elle seule, un plaidoyer puissant en faveur d’une révision constitutionnelle rapide et courageuse. Il est temps de revenir à un cadre institutionnel cohérent, maîtrisé et adapté aux réalités gabonaises, plutôt que de persister dans un régime hybride que même ses promoteurs semblent incapables d’appliquer avec constance.
Cette révision n’est pas une marque de faiblesse. C’est un acte de lucidité politique et de protection du Chef de l’État. C’est reconnaître qu’une erreur a été commise dans le conseil constitutionnel initial, et qu’il est encore temps de la corriger avant que les dégâts ne deviennent irréversibles.
Ali Akbar ONANGA Y’OBEGUE
Docteur en Droit, Enseignant à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques
Université Omar Bongo et Secrétaire Général du Parti Démocratique Gabonais (PDG)

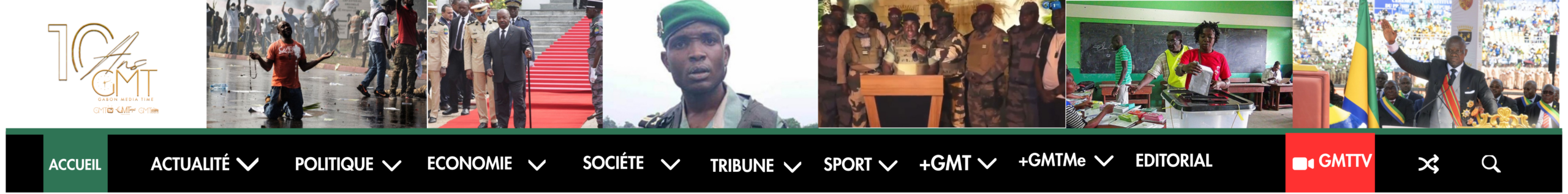








GMT TV
[youtube-feed feed=2]